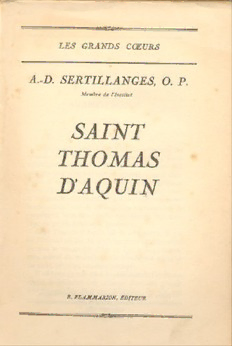
Saint Thomas d’Aquin PDF
Preview Saint Thomas d’Aquin
C’est le propre des grands cœurs de découvrir le principal besoin des temps oùilsviventetdes’yconsacrer. P.LACORDAIRE. SAINT THOMAS D’AQUIN SAINT THOMAS D’AQUIN AVANT-PROPOS L'épigraphe commune à toute la collection des Grands Cœurs se prête ici à une transposition particulièrement opportune. Les grands hommes ont compris leur temps et lui ont apporté ce qu'il cherchait. A ce titre seul ils sont des héros et méritent notre culte. Mais s'ils sont parmi les plus grands, si ce sont de ces hommes qui représentent notre humanité en l'une de ses fonctions permanentes, ils perpétuent leurs bienfaits et rajeunissent leur message au profitde chaque génération. Saint Thomas d'Aquin est de ce nombre. Il y a de l'éternité en lui. Sa doctrine porte en elle-même de quoi se renouveler d'âge en âge, et sa personne, type achevé du travailleur, du bienfaiteur social et du saint, est d'un constant exemple. Il est beau de voir ainsi le problème de l'existence résolu doublement : en concepts dans une géniale Somme, en fait dansune héroïque vie. Ce que notre soif d'idéal réclame avec une presque égale exigence : tantôt de l'intelligence et tantôt de la sainteté, un seul homme nous l'apporte. Bien mieux, il nous l'apporte étroitement conjoint, et c'est une harmonie nouvelle. En lui, www.thomas-d-aquin.com 3 LES GRANDS CŒURS la sainteté est une requête du savoir et le savoir un appel du saint. Il estl'homme lumière. Aujourd'hui que par l'excès des lumières anarchiques et la poussée d'instincts indisciplinés notre monde est en désarroi, c'est bien le moment de lui mettre sous les yeux un tel modèle. Qu'il médite sur l'image d'un penseur raccordé à l'universel et d'une âme toute donnée aux valeurs suprêmes; c'està quoi voudraitaiderpoursa partce rapide travail Rosemont, 8 septembre 1930. 4 www.thomas-d-aquin.com SAINT THOMAS D’AQUIN CHAPITREPREMIER LETEMPSETL'APPEL DUTEMPS On a souvent décrit ces débuts du XIIIe siècle, où des forces bouillonnantes et des états d'esprit confus pouvaient désorienter pour longtemps la pensée et la civilisation chrétiennes. Mon confrère le P. Mandonnet, dans un ouvrage désormais classique1, a tracé de cette époque un puissant tableau. En ce qui concerne notre objet, quelques traits suffiront, faciles à marquer et par eux-mêmes assez frappants pourrendreinutilel'insistance. Notre Occident était foncièrement chrétien; il l'était dans les moelles, le christianisme ayant présidé à sa formation, veillé sur son berceau, inspiré ses institutions et nourri sa pensée de toute la sève doctrinale élaborée séculairement d'après l'Évangile. Cette possession d'une doctrine de vie était le trésor par excellence de ces temps, où l'inconscience d'une civilisation en désarroi voudrait voir un âge de ténèbres. Or, à ce moment, une crise menaçait, autrement redoutable et décisive que celle qu'amèneraient, au XVI e siècle, des causes assez semblables. Il s'agissait, comme 1 R. P. P. Mandonnet. Siger de Brabant et l'averroïsme latin au XIII siècle www.thomas-d-aquin.com 5 LES GRANDS CŒURS toujours, d'un progrès; mais le progrès des institutions, comme la croissance des vivants, ne se fait pas sans péril ; manqué, le tournant s'appelle déviation, et dans une société non encore stabilisée, à l'égard d'une doctrine complète en son fond, mais non systématisée, imparfaitement adaptée aux données générales de la pensée humaine et de l'humaine expérience, la déviation pouvaitêtre fatale. En quoi consistait le progrès? Dans un apport venu de l'antiquité, comme au temps des Marsile Ficin, des Pic de la Mirandole, des Erasme. Par des canaux lointainement chrétiens, mais plus prochainement et plus spécifiquement arabes, judaïques pour une part, pour une part alexandrins, la philosophie et l'esprit grecs envahissaient la chrétienté. C'était un souffle vivifiant, mais qui se précipitait en cyclone, qui d'ailleurs confondait dans une même atmosphère des élémentstoniquesetde réelspoisons. Aristote était le dieu nouveau ; ses écrits, grossis de commentaires tendancieux, insuffisants par eux-mêmes et capables, en raison de leur naturalisme excessif et de certaines tares particulièrement graves, de dévoyer les intelligences chrétiennes, trouvaient dans les écoles des sectateurspassionnés, prêtsà outrepassertoutesles bornes. La doctrine même de Dieu risquait d'y périr. Car le Dieu d'Aristote, le XIIe livre de la Métaphysique le dessine en quelques traits sublimes, mais équivoques. Avec beaucoup de bienveillance - Thomas d'Aquin en aura des trésors - on peut achever ces traits en un dessin harmonieux, mais combien pauvre! Ni la personnalité divine n'est précisée, ni la providence ne s'affirme, ni même la liberté créatrice ne s'aperçoit. Dieu est cause finale : est-il aussi cause efficiente ? 6 www.thomas-d-aquin.com SAINT THOMAS D’AQUIN C'estobscur, si ce n'estfranchementnié. Et ainsi en est-il de l'âme. L'âme est, pour Aristote, quelque chose de supérieur à la matière; elle est « séparée»; elle arrive à la chairnaissante «dudehors» etcomme «parla porte». Mais cet arrivage est-il un vrai don? L'âme pensante est-elle chose individuelle ? Chaque homme est-il, par elle, assuré d'une vie supérieure réellement propre et qui-dépasse là mort? Sommes-nous - et jusque là responsables? L'aspiration morale est-elle un optatif, un objet de persuasion, ou un ordre, tellement qu'on puisse dire : Dieu est Dieu et la conscience est son prophète? Tout cela est incertain, obscur, ambigu. Chez les commentateurs, et surtoutlesArabes, cela tourne aux piressens. Or on se dit maintenant aristotélicien, partisan d'Averroès, d'Avicenne, d'Avicebron, de Maimonide, en oubliant parfois de se sentir chrétien. Or en vient ainsi à contester, au nom du «Philosophe» et de ses séides, les thèses les mieux assurées et le: plus fondamentales de la doctrine catholique, La création du monde dans le temps, le gouvernement divin et la paternité céleste, l'individualité spirituelle de l'âme et sa destinée immortelle, le libre arbitre et la responsabilité morale font place, en certains milieux scolaires, à un monde éternel, à un Dieu abstrait coupé de communication avec son œuvre, à un Intellect unique pour tous les hommes et seul immortel, à un strict déterminisme physique et psychologique excluant l'action responsable, etc., etc. C'est la science. Et comme pourtant, dans un tel milieu, la foi chrétienne ne peut être attaquée de front, comme sur elle reposent les institutions et en son nom se propose l'enseignement même, on trouve ce biais, qui provoquera un jour les protestations indignées de saint Thomas: Sans www.thomas-d-aquin.com 7 LES GRANDS CŒURS doute! la foi est vraie; nous ne la contredirons pas; mais nous parlons, nous, en philosophes. Philosophiquement, on doitdire ceci ; chrétiennement, onpeutdire cela : autre point de vue, autres solutions; autre discipline, autres principes. On distingue déjà, comme fera tout aussi sérieusement Jules Soury, entre «oratoire etlaboratoire». Il y avait là pour l'intelligence chrétienne deux périls contraires : un péril de méconnaissance, un péril de défection. Rejeter un apport aussi précieux que la sagesse antique retrouvée, avoir ou paraître avoir la raison humaine contre soi, c'était grave. Mais aussi, céder devant des forces animées de paganisme et d'orgueil; et ouvrir la voie aux erreurslespluspernicieuses, n'était-ce pasmortel P Une seule solution : adopter les nouveaux venus et les convertir; recevoir le cadeau suspect et en faire une richesse pute; au lieu de rejeter par une prudence poltronne un système de pensées humaines éminent entre tous, l'adapter à la sagesse chrétienne en l'interprétant, le révisant, le redressant, l'achevant, et ainsi l'accomplir. Ce serait l'œuvre de saintThomas. Mais une telle solution, claire après coup, n'apparut point d'abord; la concevoir et être capable de la réaliser, c'était presque la même chose. Il était plus facile de protester, de réagirviolemmentetde serejeterendessenscontraires. A l'opposé du mouvement aristotélicien et rationaliste, un courant mystique très puissant se prononçait, rattaché à saint Augustin et à saint Bernard, pénétré en grande partie de spiritualité franciscaine, à ce titre très vénérable, mais se laissant entraîner volontiers à exalter la foi jusqu'au dédain de laraisonetdelascience,auxquellesoncontestaitpratiquement 8 www.thomas-d-aquin.com SAINT THOMAS D’AQUIN leurautonomie,leursméthodes,leursprincipespropres. De ce côté-là, Aristote était un suspect, et suspects avec lui, plus ou moins, ceux qui prétendaient introduire en théologie ses procédés dialectiques et ses thèses. On écartait avec horreur, cela va de soi, les négations outrancières; mais en outre, on marquait une défiance tenace à l'égard de tout ce mouvement derenaissance,quiparaissaitmenacerl'antiquefoi. A quoi bon tant de recherches et de subtiles argumentations, quand on peut boire aux sources de certitude? Cette raison orgueilleuse sert-elle à autre chose qu'à troubler les âmes, à soulever des questions oiseuses, à émettre des doutes là où la foi apporte des solutions, et à frayer ainsi les voies à l'hérésie et au schisme? On ne manquait pas de noms à citer, quand on dénonçait les fauteurs de nouveautés pernicieuses, penseurs présomptueux que ne retenait nulle autorité, qui portaient le rationalisme si loin qu'on se demandait op était leur christianisme, qui entendaient tout prouver, même les mystères, et tout contrôler, fût-ce la parolede Dieu. On avait tant fait que cette question des rapports de la raison et de la foi était devenue inextricable. Des esprits comme Anselme y avaient achoppé. Lui, grand conciliateur, mystique et philosophe, également habile à la dispute et enclin à l'adoration, n'avait pu procurer l'apaisement. Le mysticisme ratiocinant et le rationalisme théologien s'affrontaient dans les ombres. On passait sans s'en apercevoir de ce qui se démontre à ce qui se croit, du dogme à la science, à moins que sans s'en apercevoir encore et surtout sans en avertir, on n'annihilât plus ou moins l'un ou l'autre. On embrouillait les questions pour les éclaircir; on invitait à mettre en doute ce qu'on se targuait de prouver, ou www.thomas-d-aquin.com 9
