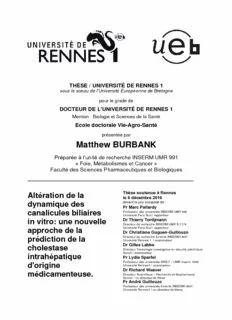
Matthew BURBANK PDF
Preview Matthew BURBANK
ANNÉE 2016 THÈSE / UNIVERSITÉ DE RENNES 1 sous le sceau de l’Université Européenne de Bretagne pour le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1 Mention : Biologie et Sciences de la Santé Ecole doctorale Vie-Agro-Santé présentée par Matthew BURBANK Préparée à l’unité de recherche INSERM UMR 991 « Foie, Métabolismes et Cancer » Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques Altération de la Thèse soutenue à Rennes le 6 décembre 2016 dynamique des devant le jury composé de : Pr Marc Pallardy canalicules biliaires Professeur des universités INSERM UMR 996 Université Paris Sud / rapporteur in vitro: une nouvelle Dr Thierry Tordjmann Directeur de recherche INSERM UMR S 1174 approche de la Université Paris Sud / rapporteur Dr Christiane Guguen-Guillouzo prédiction de la Directeur de recherche Emérite INSERM U991 Université Rennes 1 / examinateur Dr Gilles Labbe cholestase Directeur Toxicologie investigative en sécurité préclinique Sanofi / examinateur intrahépatique Pr Lydie Sparfel Professeur des universités IRSET – UMR Inserm 1085 d'origine Université Rennes1 / examinateur Dr Richard Weaver médicamenteuse. Directeur Scientifique – Recherche et Biopharmacie Servier / co-directeur de thèse Pr André Guillouzo Professeur des universités Emérite INSERM U991 Université Rennes1 / co-directeur de thèse Remerciements Une thèse, c’est comme un film au cinéma, on hésite à aller le voir, et après en avoir discuté avec les amis, on est de plus en plus sûr d’y aller. Lorsque l’on y est, on rit, on pleure, on s’amuse, on réfléchit, bref, c’est un véritable ascenseur émotionnel… Je voudrais tout d’abord remercier bien évidemment mes deux réalisateurs : Pr André Guillouzo et Dr Richard Weaver. André, vous avez mené à la perfection votre rôle de réalisateur. Depuis le début à mon écoute, vous m’avez inculqué votre savoir-faire, tout en me laissant une liberté et une confiance absolues. Travailler à vos côtés, c’est apprendre chaque jour un petit peu plus, et c’est surtout se passionner davantage pour ce métier. Richard, it was really great to work with you. I appreciate your confidence in my ambitious goals, and your efforts to provide me with all the required facilities. Thank you for all your positives remarks about the work. It is always really encouraging. Thanks to you, my work was adapted to the pharmaceutical industry. What would fundamental research be without the involvement of the pharmaceutical industry? Having a foothold in both public and private industries gives my career strength. Je voudrais également remercier le Dr Christiane Guguen-Guillouzo, notre scénariste. Grâce à vous, ce film a pris des tournures différentes, avec des intrigues différentes et souvent de nouveaux dénouements. Il a toujours été agréable d’écouter vos conseils de scénariste aussi bien au niveau de mon jeu d’acteur qu’au niveau des modifications du script. Un grand merci pour tous vos conseils et promis, je n’oublierai jamais de « borner » mes valeurs. Je tiens à exprimer tous mes remerciements à l’ensemble des membres du jury : Pr Marc Pallardy, Dr Thierry Tordjmann, Dr Christiane Guguen-Guillouzo, Dr Gilles Labbe, Pr Lydie Sparfel. Je vous remercie de m’avoir fait l’honneur de juger ce film et j’espère que vous apprécierez son histoire en lui décernant,peut être une palme ce soir ? Je voudrais exprimer toute ma gratitude envers mes producteurs : L’INSERM U991 et Biologie Servier. Merci de m’avoir permis de jouer dans ce film et dans les meilleures conditions possibles Au sein de L’INSERM U991, merci à mes deux directeurs de production, Bernard et Marianne, merci d’avoir guidé ce film et de m’avoir soutenu tout au long de cette aventure. Merci à mes deux collègues Doudou et Simon, des acteurs géniaux qui m’ont permis de m’émanciper dans nos studios comme dans la région bretonne (hostile). Sans vous la thèse n’aurait pas été aussi « stylée ». Merci à ma Camcam, tu es une actrice grandiose et ta carrière ne fait que commencer, merci de m’avoir appris beaucoup de choses à mon arrivée dans le studio, et merci de m’accompagner depuis le début de ma vie bretonne. Merci à mon coach Ahmad d’avoir été d’une aide si précieuse dans ce projet. Enfin merci à tous mes collègues et acteurs, Nico, Tatiana, Anaïs, Thomasx2, Sacha, Florence, Aude, Sophie, Karima, Pegah, Houssein, Audrey, Eva sans oublier Patoche sans qui le projet cinématographique n’aurait pas eu de secrétaire. C’est grâce à vous également que l’histoire s’est écrite. Merci à mes collègues de Biologie Servier, Hélène et Hervé de m’avoir accueilli dans vos studios et d’avoir aidé à la réalisation de ce film. Merci à Nancy Claude, chargée de production d’avoir appuyé ma candidature en tant que premier rôle dans ce film. Merci à Rémy Le Guevel, notre cadreur, de nous avoir fait profiter de la plateforme Impacell afin de réaliser tous nos effets spéciaux. Merci à mes amis d’enfance d’avoir toujours été à mes côtés (mais vous pouvez également me remercier de vous avoir invités à toutes les soirées post production en bretagne que vous connaissez maintenant si bien) Je voudrais enfin exprimer ma profonde gratitude à ma famille : les frangins, Max et Jer, d’avoir suivi de près comme de loin toute ma carrière d’acteur depuis le début. J’espère que vous aimerez ce film et surtout le comprendrez ! Enfin un énorme merci à Moon et Dad d’avoir toujours été mes premiers fans ! De mes premiers pas dans le cinéma, il y a bien longtemps, jusqu'à aujourd’hui qui marque le début de ma carrière internationale, c’est aussi grâce à votre amour et votre soutien que je ressors plus fort de chaque expérience. Ax, ma femme, que serait ce film si tu ne m’avais pas aidé à l’écrire depuis notre rencontre à la fac. Tu es en même temps ma productrice, ma réalisatrice et mon actrice préférée. Notre autre Big production, avec un script béton, une histoire magique, ne fait que commencer et comme on aime les challenges, le dépassement de soi et les rebondissements…on a toutes nos chances pour le prochain Oscar ! Abstract Intrahepatic cholestasis represents a frequent manifestation of drug-induced liver injuries; however, the mechanisms involved in such injuries are poorly understood. We aimed to investigate mechanisms underlying drug-induced cholestasis and improve its early detection using human HepaRG cells. First, we proved that bile canaliculi (BC) underwent spontaneous contractions, which are essential for bile acid efflux and required alternations in myosin light chain (MLC2) phosphorylation/dephosphorylation. A short exposure to cholestatic compounds revealed that BC dynamics was altered and associated with impairment of the ROCK/MLCK pathway. Then, in order to confirm our study, 12 cholestatic drugs and six noncholestatic drugs were analyzed and we demonstrated that all cholestatic drugs classified on the basis of reported clinical findings caused disturbances of both BC dynamics (dilatation or constriction), and alteration of the ROCK/MLCK signaling pathway, whereas noncholestatic compounds had no effect. We also proved that these changes were more specific than efflux inhibition measurements alone as predictive nonclinical markers of drug-induced cholestasis. To confirm and extend these conclusions, we analyzed the mechanisms involved in cytotoxic and cholestatic effects induced by the 4 main drugs from the endothelin receptor antagonists family: two related to clinical cases of hepatotoxicity (sitaxentan) and/or cholestasis (bosentan), and two that have not been reported to cause elevation of liver transaminases or bilirubin (ambrisentan and macitentan). The results showed that like bosentan, the structurally similar recently marketed drug, macitentan, could cause in vitro major BC alterations. By contrast, ambrisentan appeared as a safe drug and sitaxentan that has been withdrawn from the market for hepatotoxic cases, did not impair BC dynamics. Résumé La cholestase intrahépatique est une manifestation fréquente des lésions hépatiques induites par les médicaments; Cependant, les mécanismes impliqués sont peu connus. Nous avons cherché à étudier les mécanismes de la cholestase induite par les médicaments afin d’améliorer sa détection précoce en utilisant les cellules HepaRG humaines. Tout d'abord, nous avons prouvé que les canalicules biliaires (BC) subissaient des contractions spontanées, essentielles pour l'efflux d’acides biliaires et nécessitaient des séries d’alternance dans la phosphorylation/déphosphorylation de la chaîne légère de myosine (MLC2). La courte exposition à des composés cholestatiques a révélé que la modulation des BC était associée à des perturbations de la voie de signalisation ROCK/MLCK. Afin de confirmer notre étude, 12 médicaments cholestatiques et six non cholestatiques ont été analysés et nous avons démontré que tous les médicaments cholestatiques classés sur la base de résultats cliniques provoquaient des perturbations dans la dynamique des BC (dilatation ou constriction), et altéraient la voie de signalisation ROCK/MLCK, tandis que les composés non cholestatiques n'avaient pas d'effet. Nous avons également prouvé que ces changements étaient plus spécifiques que la mesure de l'inhibition de l’efflux comme marqueurs prédictifs non cliniques de la cholestase induite par les médicaments. Afin de confirmer et d’étendre ces conclusions, nous avons analysé les mécanismes impliqués dans les effets cytotoxiques et cholestatiques induits par 4 médicaments de la famille des antagonistes des récepteurs de l'endothéline: deux ayant un lien avec des cas cliniques d'hépatotoxicité (sitaxentan) et/ou cholestase (bosentan), et deux n’ayant pas été impliqués dans l’élévation de transaminases hépatiques ou de bilirubine (ambrisentan et macitentan). Les résultats montrent que le macitentan récemment commercialisé et ayant une structure chimique similaire à celle du bosentan, était capable de causer, comme ce dernier, des altérations in vitro des BC. En revanche, l'ambrisentan n’était pas hépatotoxique et le sitaxentan qui a été retiré du marché pour des cas d’hépatotoxicité, n’affectait pas la dynamique canaliculaire. Table des matières Index des figures 1 Index des tableaux 2 Liste des abréviations 3 INTRODUCTION GENERALE ......................................................................................................... 5 I. Stratégie de développement des médicaments 7 a. Données générales 7 b. L’importance de la toxicologie dans le développement préclinique 8 II. Xénobiotiques, hépatotoxicité et DILI 11 a. Le risque hépatotoxique dans le développement du médicament 11 i. Les retraits pré-AMM .......................................................................................................................... 11 ii. Les retraits post AMM ......................................................................................................................... 13 b. Les différentes lésions hépatotoxiques d’origine médicamenteuse (DILI) 14 i. Introduction et ADME .......................................................................................................................... 14 ii. Mécanismes de l’hépatotoxicité .......................................................................................................... 17 1. Classification .................................................................................................................................... 17 2. Mécanismes des DILI ....................................................................................................................... 18 a) Stress cellulaire direct ................................................................................................................. 20 b) Dysfonctionnements mitochondriaux ........................................................................................ 21 c) Réactions immunes ..................................................................................................................... 22 d) Morts cellulaires : Apoptose, nécrose ........................................................................................ 23 iii. Principales lésions hépatiques toxiques .............................................................................................. 23 1. Hépatites aiguës (cytolytiques, cholestatiques ou mixtes) ............................................................. 23 a) Hépatite cytolytique ................................................................................................................... 25 b) Hépatite cholestatique ............................................................................................................... 25 c) Hépatite mixte ............................................................................................................................ 25 2. Maladies de surcharges (lipides, phospholipides)........................................................................... 25 3. Autres pathologies .......................................................................................................................... 26 iv. Facteurs de risques de DILI .................................................................................................................. 27 1. Les facteurs non génétiques............................................................................................................ 27 2. Les facteurs génétiques ................................................................................................................... 28 III. Méthodes de détection des DILI 29 a. Le cadre réglementaire 29 b. Les études précliniques 30 c. Modèles in vitro 31 i. Foie isolé perfusé ................................................................................................................................. 32 ii. Tissus (coupes de foie) ......................................................................................................................... 33 iii. Cellules isolées en culture ................................................................................................................... 33 iv. Lignées cellulaires ................................................................................................................................ 34 1. Les cellules HepaRG......................................................................................................................... 34 v. Fractions subcellulaires ....................................................................................................................... 36 vi. Cellules recombinées hépatiques ........................................................................................................ 37 d. Modèles in silico 39 e. Essais cliniques 39 f. Le suivi post AMM et la toxicovigilance 40 IV. La cholestase 42 a. Définition 42 b. Acides biliaires 42 i. Introduction ......................................................................................................................................... 42 ii. Synthèse des acides biliaires ............................................................................................................... 44 iii. Cycle entéro-hépatique ....................................................................................................................... 47 iv. Transport des acides biliaires .............................................................................................................. 48 1. Transporteurs sinusoïdaux .............................................................................................................. 48 2. Transporteurs canaliculaires ........................................................................................................... 49 c. Etiologie 52 i. Cholestase intra-hépatique ................................................................................................................. 52 ii. La cholestase extrahépatique .............................................................................................................. 52 d. Physiopathologie 52 i. Maladies cholestatiques héréditaires .................................................................................................. 53 ii. Cholestase acquise .............................................................................................................................. 54 1. Cholestase induite par l’inflammation ............................................................................................ 54 2. La cholestase intrahépatique de grossesse ..................................................................................... 55 3. La cholestase induite par les médicaments..................................................................................... 56 a) Implication du stress oxydant ..................................................................................................... 56 b) Cholestase médicamenteuse aggravée par l’inflammation ........................................................ 57 c) Altération de la dynamique des canalicules, du cytosquelette et de la polarité cellulaire ........ 57 d) Altération des transporteurs hépatiques .................................................................................... 59 a. BSEP ........................................................................................................................................ 60 b. NTCP ....................................................................................................................................... 60 c. OATP ....................................................................................................................................... 60 d. MRP2 ...................................................................................................................................... 61 e. MRP3-4 ................................................................................................................................... 62 e. Diagnostic 63 i. Clinique ................................................................................................................................................ 63 ii. Biologique ............................................................................................................................................ 63 f. Méthode de détection de la cholestase 64 i. Modulation des transporteurs (BSEP et autres) .................................................................................. 64 3. Modèles acellulaires ........................................................................................................................ 65 4. Modèles cellulaires.......................................................................................................................... 65 ii. Etude des fonctions biliaires et de l’activité globale ........................................................................... 65 iii. Autres méthodes de détection de la cholestase ................................................................................. 66 V. Bosentan et autres ERAs 68 a. La famille des Antagonistes des récepteurs à l’endothéline (ERA) 68 i. Endothéline et récepteurs ................................................................................................................... 68 ii. Propriétés pharmacologiques.............................................................................................................. 70 b. Le Bosentan 72 i. Introduction ......................................................................................................................................... 72 ii. Mécanisme d’action ............................................................................................................................ 73 iii. Données cliniques ................................................................................................................................ 73 1. Indications thérapeutiques ............................................................................................................. 73 2. Posologie et mode d’administration ............................................................................................... 74 3. Contre-indication, mise en garde, précaution d’emploi et interactions médicamenteuses ........... 74 4. Effets indésirables ........................................................................................................................... 75 iv. Propriétés pharmacologiques.............................................................................................................. 76 1. Pharmacodynamie .......................................................................................................................... 76 2. Pharmacocinétique ......................................................................................................................... 76 3. Métabolisme ................................................................................................................................... 77
Description: