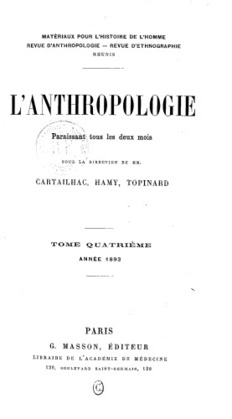
Le mirage oriental PDF
Preview Le mirage oriental
LE MIRAGE ORIENTAL PAU M. SALOMON REINACH PREMIÈRE PARTIE INFLUENCES DE L'ORIENT SUR L'EUROPE OCCIDENTALE I Il dans la science une illusion y a, archéologique, singulière- ment l'on craindre de dévoiler d'une fois tenace, que- peut plus avant d'en avoir raison. C'est ce nous abré- que appellerons, pour le oriental. ger, mirage Les effets de ce sont Nous allons d'abord en mirage multiples. rappeler quelques-uns. On sait à la fin du siècle l'impression profonde que produisit, la découverte du sanscrit les savants de dernier, par l'Europe. Parce cette avait un mécanisme que langue grammatical plus les on crut était la compliqué que autres, longtemps qu'elle mère, ou tout au moins la soeur aînée des On attribua langues aryennes. à ses monuments littéraires une on antiquité fabuleuse; supposa sans l'affirmer ou le même, toujours expressément, que Yaryaque sanscrit avait été la des hommes. M. Rréal a cité langue premiers à ce un amusant de la Grammatik propos passage Philosophische de où l'auteur traite de des du discours : Westphal, l'origine parties « Nos ancêtres ont suivi ces avec la indo-germains catégories même inconscience soutenir leur ils ont que lorsque, pour corps, saisi leur aliment, ou l'Indo-Germain a la premier lorsque pour première fois serré dans ses bras l'Indo-Germaine, laquelle, sans qu'il le sût, devait mettre au monde un homme pareil à lui- 540 SALOMON KEINACH. même » Les erreurs de ce firent si bien leur chemin (1)! genre en effervescence des éludes que lorsqu'en 1864, pleine préhisto- un faussaire s'avisa de des lettres sur des os riques, graver quater- naires, censés recueillis dans une caverne, il se contenta d'em- à la sanscrite de Burnouf et prunter grammaire Leupol quelques caractères dévanagaris (2). Les indianistes ont croient encore cru, beaucoup d'archéologues l'Inde est le berceau des de M. Bertrand que religions l'Europe. écrivait en 1882 : « L'influence directe ou indirecte de l'Inde (3) sur les rites introduits en Gaule à une encore indéterminée époque un de nous est de acquiert degré probabilité qu'il impossible méconnaître. » A la même M. de Mortillet n'hésitait époque, pas à comme une de l'Asie les sentiments reli- expliquer importation des il cherchait en Inde gieux populations néolithiques; l'origine delà croix avec celle de la civilisation du bronze Du gammée (4). monde des ces sont descendus dans le archéologues, préjugés grand ils sont sans cesse les Je lis public, auquel rappelés par journaux. dans le du 22 novembre sous la d'un homme Figaro 1893, signature très M. Henri cette : « Le distingué, Fouquier, phrase caractéristique théâtre resterait si on ne savait voir une grec incompris y pensée morale qui découle d'un fait historique : la coexistence, enliellade, de deux la venue des religions, l'une, primitive religionpélasgique, hauts plateaux de l'Asie, religion de terreur, profondément fata- venue de avec le Iacchos, liste, l'autre, peut-être l'Inde, pur Arya née dans la divine » L'Inde, la peut-être spontanément Attique. les c'est l'a et Tu de l'érudition. Haute-Asie, purs Aryas, L'idée l'hébreu est l'ancêtre de toutes les comme que langues, la civilisation serait la mère de toutes les civilisations, sémitique aussi ancienne la science chrétienne en Occident. For- paraît que tement battue en brèche la à ses débuts, par philologie comparée elle du terrain au commencement de ce mais perdit siècle, reparut bientôt sous des formes en Les apparence plus scientifiques. grandes découvertes faites en en en en Chaldée Egypte, Phénicie, Assyrie, ont donné un semblant, d'autorité à des comme celles- opinions ci : les monuments sont l'oeuvre des Phéniciens mégalithiques le bronze a été en Occident les Sémites (Nilsson) (5); porté par (1) Cité par M. BRÉAT., Mélanges de mythologie et de linguistique, p. 403. (2) Voir mes Antiquités nationales, t. I, p. 128. (3) Rev. archéoL, 1882, I, p. 322. (i) MORTILLET, Le Préhistorique, p. 613.; Musée préhistorique, texte de la pi. 99. Cotte avait été souvent. (S) hypothèse déjà proposée LE MIRAGE ORIENTAL. 541 si la Gaule était restée sans communication avec (1); (fiougemont) les centres civilisés de l'Asie, elle 'serait probablement grands à de la les anciennes encore l'âge pierre (Bertrand) (2); plus influences civilisatrices sont venues à l'Europe de l'Egypte et de l'Asie occidentale ; même si les monuments et l'histoire (Undset) (3) étaient muets, le fait que la civilisation occidentale est née au con- — tact de l'Orient serait à méconnaître On impossible (4). pouvait en la théorie de Nilsson était bien mais espérer, 1893, que morte; voilà M. Letourneau est venu déclarer, à la Société d'anthro- que de reconnaissait des caractères pologie Paris, qu'il phéniciens les sur les monuments de la parmi signes gravés mégalithiques Il est inutile de combien de fois Bretagne (8). presque rappeler on a de la science en découvrir des essayé mystifier prétendant dans le Nouveau-Monde. Mais n'a-t-on inscriptions phéniciennes vu récemment un savant de la valeur de M. Undset pas alléguer les bassins à roues du de oeuvres d'Hiram Salomon, temi^ (6), les de bronze l'on découvre dans pour expliquer petits ch^Pts que centrale aux de Hallstatt et de la ïène l'Europe époques (7)? II Quand on racontera l'évolution des sciences au historiques xixc siècle, on insistera, avec raison sur la période comprise entre 1880 et 1890; c'est alors, en effet, que s'est dessinée, timidement avec une assurance de mieux en mieux d'abord, puis justifiée par les faits, la réaction contre le « mirage oriental », la revendication desdroits de contre les de l'Asie dans l'oeuvre l'Europe prétentions obscure des civilisations. premières les de ce mouvement. Indiquons rapidement principaux épisodes Nous avons vu le « oriental » sévissait que mirage surtout, si l'on sous deux formes : l'une peut dire, aryenne (indo-iranienne), l'autre C'est contre le sémitique (assyro-babylonienne). mirage indo-iranien la de a commencé. que campagne l'esprit critique En un tout savant M. de 1879, jeune suisse, Saussure, dévelop- (1) ROUGEMONT, L'âge du bronze ou les Sémites en Occident, Paris, 186G. (2) BERTRAND, Archéol. celtique et gauloise, 2° éd., p. XII. (3) UNPSBT, Zeitschrift fur Ethnologie, t. XXIII, p. 237. (4) E. MEYER, Geschiclite des Alt.erthums, t. II, p. 34. (o) Un rocuoil sérieux a donné asile àces rêveries (Revue scientifique, 1893,1, p. 463.) (6) I Rois, VII, 27-39 ; cf. PERROT et CHIPIEZ, Histoire de l'art dans l'antiquité, t. IV. p. 330. (7) UNDSET, Zeitschrift fur .Ethnologie, t. XXII, p. 86 et suiv. 542 SALOMON REINACH. pantune idée de Bopp et de M. Brugman, publia son célèbre mémoire sur le des Il dé- système primitif voyelles indo-européennes (1). y montra que l'a, si fréquent dans les mots sanscrits, y résulte souvent de l'amalgame d'au moins trois sons différents, a, e, o, qui se sont conservés dans d'autres langues de la même famille, comme le et le latin. Le mot sanscrit est grec signifiant cheval, açva, plus du vocable ekwos Ffe™? et éloigné primitif que grec Yequos (equus) latin. Le des consonnes sanscrites n'est moins système pas profon- dément altéré. Il fallut se rendre à l'évidence, et M. écrire Sayce put en 1883 : « Le sanscrit a été détrôné de la élevée occu- place qu'il comme excellence de la pait représentant par langue-mère et l'on a reconnu bien des les euro- aryenne, qu'à égards langues ont fidèlement les sons et les formes péennes gardé plus pri- mitives ne l'ont fait les de l'Inde » Parmi ces que langues (2). une des mieux conservées est le lithuanien d'où langues, (3) ; l'appui la à la théorie nouvelle cherche prêté par linguistique qui quelque en et non dans une inhabitable de part Europe, plus partie l'Asie, le centre de diffusion des langues aryennes. III la ce fut le tour de la littérature. Pendant Après langue, long- on avait vu dans les Védas chose comme la temps, quelque pre- mière effusion lyrique de l'humanité; les plus modérés plaçaient ces obscurs vers le milieu du troisième millénium avant poèmes J.-C. Le sanscritiste anglais Muir, homme de bon sens, avait cette littérature n'était ni cependant déjà remarqué que naïve, ni primitive (4) ; mais il était réservé à Bergaigne (5) de montrer à elle est comment elle un quel point savante, présuppose grand et antérieur. il développement religieux liturgique Aujourd'hui, faut hardiesse reculer vers l'an 1000 déjà quelque pour jusque avant J.-C. les anciennes de la collection plus parties védique; des indianistes, M. de Bradke notamment, inclinent à les faire descendre bas. beaucoup plus (i) On trouvera un historique rapide de cette découverte dans mou Manuel de philologie, t. II, p. 173. \ï) SAYCE, préface à la traduction des Principes de philosophie comparée, Paris, 1884, p. xm. (3) SAYCE, Principes, p. 45. (4) Cf. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, Lehrbuch der Religionsgeschichle, t. I, p. 353, où l'on trouvera d'autres références. (5) BERGAIGNE, La religion védique, 3 vol., 1878-1883. LE MIRAGE ORIENTAL. 543 Les illusions sur la haute de l'écriture indienne n'ont antiquité résisté à la d'une science mieux armée. davantage critique pas en les anciennes Lorsque Prinsep déchiffra, 1837, plus inscrip- tions de l'Inde, il s'imagina que les alphabets dans lesquels elles sont conçues étaient antérieurs à la séparation des peuples aryens. Si l'helléniste 0. Mùller, toujours en avance sur son temps, affir- mait indou dérivait de l'indianiste que l'alphabet l'alphabet grec, Weber le faisait naître, vers l'an 1000 avant J.-C, de l'alphabet introduit dans l'Inde le commerce. en phénicien, par Or, 1884, M. me avoir établi d'une manière définitive les Halévy paraît que deux écritures de l'Inde, dérivant des alphabets grec et araméen, sont à Alexandre le Grand Le savant orientaliste postérieures (1). : « Il en résulte avec une certitude mathé- ajoutait (2) presque les Védas à forte la littérature matique que et, plus raison, qui s'y rattache, ont été mis par écrit postérieurement à cette date au me siècle av. Et comme rien ne force à croire (c'est-à-dire J.-C). les se soient conservés dans la que hymnes védiques longtemps tradition on est induit à la de ces orale, penser que composition est à Alexandre le Grand... En tous ceux hymnes postérieure cas, voudront désormais voir dans le Véda d'une anti- qui l'empreinte sans ceux le le quité reculée, compter qui prennent pour représen- tant du en auront à démolir au les génie aryen général, préalable établissent l'introduction récente de preuves paléographiques qui l'écriture dans l'Inde. » M. est revenu sur le même en 1893. Rééditant une Halévy sujet araméenne de date de la fin du v° inscription Gilicie, qui siècle, il a fait observer de ce texte est que l'alphabet encore, paléographi- quement, voisin du phénicien, alors que c'est de l'état réduit de araméen dérivent les écritures bactrienne et in- l'alphabet que dienne des monuments d'Açoka. « Il devient évident, conclut M. l'écriture araméenne ne s'est dans Halévy, que pas répandue l'Asie orientale avant, mais après l'avènement d'Alexandre le Grand. araméenne et L'origine ptolémaïque que j'ai revendiquée depuis longtemps pour les écritures indiennes reçoit ainsi une confirmation » (3). Le Véda rajeuni, ce fut le tour de l'Avesta, ce livre sacré des Persans, que l'on plaçait aussi (je parle des parties les plus an- (1) Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1884, p. 211. (2) Ibid., p. 222. , (3) HALÉVY, Revue sémitique, 1893, p. 183-186; cf. ma XXVIIe Chronique d'O- rient, p. 64. {Rev. archéol., 1S93, II.) 544 SALOMON REINACH. vers le xxe siècle avant J.-C, où quelques-uns avaient ciennes) même voulu reconnaître une mention de expresse l'époque gla- la seule texte littéraire eût conservée ! ciaire, qu'un (1) M. James Darmesteter a avec une force extraordinaire prouvé, d'argumentation, que cette littérature, qualifiée d' « abominable fatras » Voltaire est entièrement non par (2), presque postérieure seulement à Alexandre le Grand, mais à la renaissance de l'Em- 0 sous les Sassanides siècle Voici pire persan (m après J.-C). textuellement les conclusions de M. Darmesteter (3), auquel — M. Bréal— il n'est de le dès que juste rappeler avait, 1862, ouvert la voie : (4) (( au fond : Quant « La de l'Avesta essentiellement la religion représente religion de achéménide avant mais l'époque (550-336 J.-C), profondément la au contact des Grecs et pénétrée, après conquête d'Alexandre, des de et d'éléments nouveaux au néo- Juifs, principes empruntés et au platonisme judaïsme. « à la forme : Quant « Tout même dans ses les l'Avesta, parties plus anciennes, porte de ces nouveaux et en a la forme. Il a été l'empreinte principes reçu tout entier la entre le ier siècle rédigé api'ès conquête d'Alexandre, avant notre ère et le ive siècle notre ère. La où il après langue a été rédigé, le Zend, était très probablement une langue savante, une morte. » langue nous voilà loin des « balbutiements de l'huma- Que premiers nité » et même de la nomenclature du Vendidad géographique considérée comme « le bulletin de la marche de l'immigration à ses débuts » ! aryenne (5) Ces vérités mettront du à faire leur chemin mais elles temps (6), sont à toute tentative de désormais, croyons-nous, supérieures réfutation. (1) Cf. PRDNER-BEY, Premier congrès de Paris, p. 359. Dictionnaire article Zoroastre. (2) VOLTAIRE,. philosophique, (3) DARMESTETER, Le Zendavesta, Paris, 1893, t. III, p. vi. (4) BRÉAL, Mélanges de mythologie et de linguistique, p. 207. t. xxxm. (5) DARMESTETER, op. laud., I, p. M. do Nadaillac écrivait encore tout récemment 25 novembre (6) [Correspondant, 1893, p. 620) : « Le Yi-King, ou livre des changements de la dynastie des Tcheou, est le plus ancien livre que nous possédons, llprécède l'Avesta et le Màhdbhârata. » Pour être plus ancien que ces deux ouvrages, un livre peut être encore bien plus jeune que les chefs-d'oeuvre de la littérature grecque. 543 LE MIRAGE ORIENTAL. IV Quelques années plus tôt, sapé par des mains hardies, s'é- croulait l'édifice du soi-disant panthéon aryen, où, depuis le fameux livre de Kuhn (1852), s'abritait l'idée que les dieux des étaient, les et les frères mylhologies européennes homonymes des dieux intlous. puînés Il faut s'arrêter un instant sur cette démolition mémorable, à lire ce le n'en a parce qu'on penserait, qui s'imprime, que public encore entendu parler. point A la suite des travaux de Kuhn, Benfey, Max Mùller, Grass- mann et d'autres, on en était arrivé à croire que les noms des divinités grecques se retrouvaient, le plus souvent sous forme et dans les Yédas ou les indous d'épithètes d'appellatifs, poèmes Zeus à ciel Ouranos postérieurs. correspondait Dyàus (le lumineux), à Varuna firmament voilé ou Athèna à Ahanâ (le nocturne), (la de Hermès à brûlante, épithète l'Aurore), (Hermeias) Surameya Cerbère à d'un (un chien), Çabala (le tacheté, épithète chien) (1), à les Centaures aux Bellérophon Vritrahân, Gandharva, Erinnys à etc. Saranyu, Ces d'où l'on concluait à l'existence non d'une identifications, est mais d'une commune aux religion (ce qui possible), mythologie encore indivis, blessaient tantôt la tantôt Aryens phonétique, — les données de la tantôt et souvent mythologie elle-même, plus — encore le bon sens s'étaient fait (2). Quelques protestations motivées surtout les accu- entendre, par extravagances qu'avaient mulées, dans cet ordre d'études, MM. Max Mùller et Emile Burnouf. Un l'avenir de l'école de Kuhn fut le symptôme inquiétant pour silence M. Bréal à de date de la qu'observa partir 1866, publication do son essai sur le En M. James Dar- mythe d'OËdipe. 1884, mesteter écrivait : « La n'a tenu ses (3) mythologie comparée pas La ressemblance du et du promesses... frappante grec homérique sanscrit fait illusion : autant les deux se védique langues rap- autant les » Dès Mannhardt prochent, religions divergent. 1877, avait combattu la théorie de Kuhn en ne laissant énergiquement (1) La forme rapprochée do Kerberos était Karvura, indiquée avec la même signifi- cation que Çabala par un'dictionnaire indou. Cf. GRUPPÈ, Grieckisckc Culte, p. 114. (2) Je ne les avais pas moins accueillies, presque sans réserves, dans mon Manuel de 344. philoloyie, 1883, p. (3) ïteuue archéologique, 1884, II, p. 467. L'ANTHROPOLOGIE. — T. îv. 35 54G SALOMON REINACH. subsister très nombre des identifications qu'un petit proposées par lui et par ses élèves; mais le coup définitif ne fut porté qu'en 1887 ' M. Otto dans un livre admirable n'a eu par Gruppe, qui peut-être pas lecteurs chez nous Une seule identification cinq (4). surnageait après le naufrage, celle de Dyàus avec Zeus ; mais il ne fallait pas en con- clure à l'existence d'un « dieu » ainsi dénommé chez les suprême indivis. Comme est le ciel dans les dési- Aryens Dyàus Védas,Zeus ciel en témoin Ssi gnaitprimitivcmentle grec, l'expression Zeuç,signi- fiant « il ». Ainsi les Grecs et les Indous ont le pleut euprimitivement même mot le ils l'ont même du nom de pour ciel, appelé père (celui qui mais rien ne aient entendu là une divi- féconde), prouve qu'ils par nité comme le De toute la d'à Jupiter classique. mythologie peu près — élaborée l'école il ne restait donc rien phonétiques par indianiste, rien le souvenir et le d'une stérile débauche d'érudition. que regret Ainsi la la la de l'Orient langue, littérature, l'écriture, religion se trouvaient tour à tour de leur ; mais le aryen dépouillées prestige terrain de la libre recherche était encore loin d'être déblayé. V J'ai raconté ailleurs avec détail à son (2) comment, reprenant insu une thèse du géologue J.-J. d'Omalius, l'indianiste Benfey émit l'idée, en 1869, que le centre de diffusion des langues devait être cherché non dans l'Asie mais en aryennes pas centrale, Sa contre la théorie sur des Europe. protestation régnante l'origine « nomades » comme celles se succédèrent de loin Aryens (3), qui en loin très médiocrement l'attention. jusqu'en 1886, n'appela que En 1884 M. laissait sous son nom la encore, Sayce imprimer suivante : « On a la demeure phrase prouvé, je crois, que pre- mière de nos ancêtres fut l'Asie et les aryens plus particulièrement hauts de l'Hindou-Kousch » la suite de plateaux (4). Ajoutons qu'à la du livre de M. Penka l'ori- publication (1886), qui plaida pour Scandinave des M. fut un des à se gine Aryens, Sayce premiers à la nouvelle à il est resté fidèle et ranger doctrine, laquelle qu'il a fait tous ses efforts pour propager (5). Die Culte tend in ihren zu den (1)0. GRUPPE, griechischen Mythen Beziekungen orientalischen Religionen, t. I (seul paru), Leipsig, 1887. (2) S. REINACH, L'Origine des Aryens, histoire d'une controverse, Paris, Leroux, 1892. L'idée les indivis étaient des nomades n'a été réfutée do nos (3) que Aryens que jours par M. Much (cf. son beau livre, Die Kupferzeit in Europa, 2e éd., Iéna, 1893). de trad. 272. (i) SAYCE, Principes philologie comparée, franc., p. (5) PENKA, Die Herkunft der Àrier, Vienne, 1886; cf. SAYCE, Report of the British association for the advancement of Science, 1887, p. 889. LE MIRAGE ORIENTAL. 547 Il y a, dans ce livre de M. Penka, deux choses à distinguer : un relatifs à roman préhistorique (les chapitres l'époque quaternaire) et une réfutation très sérieuse de la théorie des origines asiatiques. Cette dernière ne me avoir été affaiblie les contro- paraît pas par verses a suscitées et les adhésions lui sont venues en très qu'elle nombre. On encore discuter sur le centre de grand peut européen la diffusion des langues aryennes (Russie méridionale, Pologne, du vallée du mais aucune Allemagne Nord, Scandinavie, Danube), bien informée et sans idées ne s'avisera personne préconçues plus de le. chercher en Asie. Pictet avait attribué aux indivis la connaissance des Aryens métaux : il était donc de les identifier avec les hom- impossible mes de avec les constructeurs des dolmens. l'époque néolithique, La des savants à de M. attri- plupart français, l'exemple Bertrand, buaient la civilisation à des néolithique populations innomées, venues, bien entendu, de l'Orient, et ne faisaient entrer en scène les des Aryens, également d'origine asiatique, qu'avec l'apparition armes de bronze et du rite de l'incinération. La revision de la de Pictet paléontologie linguistique par M. Schrader modifia ces idées : on reconnut les indivis que Aryens sortaient à tant est en du néolithi- peine (si qu'ils sortaient) stage se servaient encore de couteaux de que, qu'ils pierre (lat. saxum, allem. et le seul métal dont ils eussent connais- sax) que quelque sance était le à l'état de minerai Dès cuivre, peut-être (aes). lors, il devenait de considérer comme les « possible aryennes populations innomées » de M. sinon tout au du moins à la Bertrand, début, fin de et c'est ce ne de faire l'époque néolithique; que manqua pas M. Penka. Examinons ce subsiste de la théorie d'une double qui aujourd'hui invasion, ou, tout au moins, d'une double influence orientale. Pour cela, nous laissons de côté la de la nationalité des en- question vahisseurs à vrai n'a rien de Car si la civi- qui, dire, scientifique. lisation des constructeurs de contrairement à dolmens, était, l'opinion de Pictet, analogue à celle des Aryens indivis, cette civi- lisation n'était nécessairement aux à l'exclu- pas propre Aryens sion d'autres peuples. Qu'on appelle les constructeurs de dolmens ligures, ibères ou même touraniens : rien ces n'empêcherait que ibères ou eussent à la civilisation des touraniens, ligures participé tnbus habitaient le même Si nous devons aryennes qui continent, jamais savoir chose de la les hom- quelque langue que parlaient mesà l'on doit les ce sera seulement l'étude de qui dolmens, par
