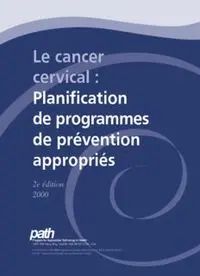
Le cancer cervical PDF
Preview Le cancer cervical
Le cancer cervical : Planification de programmes de prévention appropriés 2e édition 2000 1455 NW Leary Way, Seattle, WA 98107-5136, USA Ce document a été élaboré grâce au soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates à l’ACCP : Alliance for Cervical Cancer Prevention (2000). ii Le cancer cervical : Planification de programmes de prévention appropriés 2e édition 2000 Program for Appropriate Technology in Health Ce document a été élaboré grâce au soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates à l’ACCP : Alliance for Cervical Cancer Prevention (2000). © Path, 2000. Tous droits réservés. Traduit par le Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyons, France. ii Utilisation de ce document Toute partie de ce document, Le cancer cervical : Planification de programmes de prévention appropriés, 2e édition, peut être reproduite ou adaptée en fonction des besoins locaux et ce, sans l’autorisation préalable de PATH, à condition que PATH soit cité et que le matériel puisse être utilisé à titre gracieux ou à prix coûtant. Veuillez envoyer un exemplaire de toute adaptation à l’adresse suivante : Cervical Cancer Prevention Team PATH (Program for Appropriate Technology in Health) 1455 NW Leary Way Seattle, WA 98107-5136 USA Téléphone : (+00 1) (206) 285-3500 Télécopie : (+00 1) (206) 285-6619 Email : Remerciements Les principaux auteurs du manuel intitulé Le cancer cervical : Planification de programmes de prévention appropriés, 2e édition sont Cristina Herdman et Jacqueline Sherris. Ont également participé à cet ouvrage les auteurs suivants : Amie Bishop, Michele Burns, Patricia Coffey, Joyce Erickson, John Sellors et Vivien Tsu. Leur contribution a été essentielle. Ce document a, en outre, pu être élaboré grâce au soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, via l’ACCP, Alliance for Cervical Cancer Prevention. Ce document, Le cancer cervical : Planification de programmes de prévention appropriés, 2e édition (version anglaise : Planning Appropriate Cervical Cancer Prevention Programs, 2nd Edition), constitue la version revue et corrigée de Planning Appropriate Cervical Cancer Control Programs, publié par PATH en 1997. La première édition de cette publication a été préparée par une équipe du programme PATH, qui travaille sur une série de problèmes liés à la prévention du cancer cervical. Jacqueline Sherris en est l’auteur principal ; Amie Bishop, Elisa Wells, Vivien Tsu et Maggie Kilbourne-Brooke ont également participé à cette première version. Les auteurs souhaitent remercier les personnes ayant fourni des informations relatives aux dossiers présentés. Ces personnes sont : Dr José Camacho (Cuban National Cancer Control Program, Havana, Cuba) ; Dr Carolina Wiesner (National Institute of Cancer, Bogotá, Colombia) ; Dr Concepción Bratti (Projecto Epidemiológico Guanacaste, San José, Costa Rica) ; Dr Eric Suba (Viet/American Cervical Cancer Prevention Project, San Francisco, California, USA) ; Dr Sharon Fonn (Women’s Health Project, Johannesburg, South Africa). Les auteurs souhaitent également remercier les personnes ayant participé à la révision de ce document : Dr Catterina Ferrecchio (Organisation Panaméricaine de la Santé, Washington, D.C., USA) ; Dr Lynne Gaffikin (JHPIEGO Corporation, Baltimore, Maryland, USA) ; Dr Martha Jacobs (AVSC International, New York, New York, USA) ; Dr Silvana Luciani (Organisation Panaméricaine de la Santé, Washington, D.C., USA) ; Dr D.M. Parkin (Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon, France) ; Dr Raquel Requejo (Organisation Panaméricaine de la Santé, Washington, D.C., USA) ; Dr Sylvia Robles (Organisation Panaméricaine de la Santé, Washington, D.C., USA ; Dr Sankaranarayanan (Centre International de Recherche sur le Cancer, Lyon, France). Leurs commentaires et leurs conseils ont été essentiels et ont permis d’élaborer un document clair et précis. Toute imprécision présente dans le texte est de la responsabilité de son auteur. Tous les commentaires concernant ce document sont bienvenus, qu’il s’agisse de suggestions visant à apporter des améliorations ou des commentaires de lecteurs sur l’utilisation de ce document lors de formations de soignants, preneurs de décisions et autres. Veuillez envoyer vos commentaires à l’adresse suivante : Table des matières Résumé des recommandations principales 1 Analyse Cancer cervical : amplitude du problème 3 Dossiers 1. Histoire naturelle du cancer cervical 7 2. Dépistage : test de Papanicolaou (frottis cervical) 11 3. Dépistage : méthodes visuelles 15 4. Dépistage : diagnostics VPH 21 5. Technologies et méthodes thérapeutiques 25 6. Stratégies de suivi 29 7. Cancer cervical : stades avancés et soins palliatifs 33 8. Évaluation et surveillance des programmes 37 9. Prévention du cancer cervical : prise en compte des besoins des femmes 41 10. Lobbying en faveur du dépistage et du traitement du cancer cervical 45 Considérations relatives au programme Lancement d’un programme efficace de prévention du cancer cervical 49 Considérations financières 55 Profils des pays Afrique du Sud : actions d’une organisation en faveur de l’adoption d’une nouvelle politique de santé 67 Colombie : actions de prévention du cancer cervical, menées au cours de la réforme des soins de santé 69 Costa Rica : soutien des taux de participation dans une région à haute incidence 71 Cuba : utilisation de la recherche lors de l’élaboration de recommandations de dépistage 73 Viêt Nam : établissement d’un programme de dépistage par test de Papanicolaou 75 Glossaire 77 Bibliographie annotée 81 v Résumé des recommandations principales Au cours de la dernière décennie, de nombreux articles ont traité des difficultés liées à la prévention du cancer cervical dans des environnements aux ressources limitées et ont présenté les stratégies susceptibles d’être les plus efficaces dans ce type d’environnement. Ce document passe en revue les recherches récentes, présente les expériences entreprises au cours de ces programmes, ainsi que les analyses associées à la prévention du cancer cervical, en insistant particulièrement sur les implications des programmes et des stratégies adoptés. L’objectif de ce document est d’offrir une aide aux gestionnaires des programmes et aux preneurs de décision lors de l’élaboration de nouveaux programmes de prévention du cancer cervical ou lors de l’extension de programmes déjà existants. Cette publication peut également constituer une référence pour les professionnels de la santé, le personnel administratif, ainsi que pour toute autre personne souhaitant être informée sur les concepts clés associés à la prévention du cancer cervical. Les recommandations de ce document sont applicables à tous les programmes, quel que soit leur emplacement ; sont également incluses dans ces recommandations des remarques propres aux programmes aux ressources limitées. Pour avoir un impact sur le taux d’incidence du cancer cervical et le taux de mortalité due à ce cancer, les objectifs minimaux répertoriés ci-dessous doivent être atteints : ◗ Informer les populations sur le cancer cervical et encourager les femmes âgées de 30 à 50 ans à entrer en contact avec les services de prévention, en soulignant la nécessité pour les femmes entre 35 et 50 ans de subir un test de dépistage du cancer cervical. Les femmes de cette tranche d’âge constituent un groupe cible approprié pour un nouveau programme de prévention du cancer cervical dont les ressources seraient limitées. ◗ Dépister toutes les femmes âgées de 35 à 50 ans au moins une fois, avant d’étendre le dépistage à d’autres tranches d’âge ou de diminuer l’intervalle entre les tests de dépistage.* ◗ Soigner les femmes atteintes de dysplasie de haut grade, diriger les femmes atteintes de cancer invasif vers les services appropriés et proposer des soins palliatifs aux femmes dont le cancer est à un stade avancé. ◗ Recueillir des données statistiques relatives aux prestations de services et, à l’aide de ces données, faciliter le contrôle et l’évaluation continus des activités et des résultats des programmes. Lorsqu’un nouveau programme est élaboré ou qu’un programme existant est étendu, il est essentiel de mettre en place une gestion solide des stratégies du programme et d’obtenir le soutien et la participation de l’ensemble des intervenants du système de santé. Pour obtenir ce soutien, il est important de faire * Dans les pays où les ressources sont limitées, l’objectif doit être de dépister chaque femme du groupe cible une fois au cours de son existence, à l’âge de 40 ans, approximativement. Lorsque des ressources sont disponibles, la fréquence de dépistage doit augmenter et un test doit être effectué une fois tous les 10 ans, puis une fois tous les 5 ans pour les femmes âgées de 35 à 55 ans. Lorsque de nombreuses ressources sont disponibles et qu’une large proportion du groupe cible a pu subir un test de dépistage, le dépistage doit être étendu, dans un premier temps aux femmes plus âgées (jusqu’à 60 ans), puis aux femmes plus jeunes (à partir de 25 ans). Lorsque des ressources supplémentaires sont disponibles et qu’une proportion élevée du groupe cible subit un test de dépistage tous les 5 ans, la fréquence de dépistage doit alors être augmentée et un test doit être pratiqué tous les 3 ans, entre 25 à 60 ans. 1 clairement état de la nécessité impérieuse de mettre en place un programme de prévention du cancer cervical. Il est également essentiel d’effectuer une analyse des coûts estimés et de l’impact attendu des stratégies de programme proposées. La collaboration des soignants et des femmes susceptibles de participer au programme doit également être obtenue afin que ceux-ci prennent part à l’élaboration du programme, à sa mise en œuvre et à son évaluation. Leurs points de vue et leurs besoins seront ainsi pris en compte. Il est absolument essentiel que la conception et l’instauration des programmes soient basées sur les résultats substantiels de recherches portant sur la prévention du cancer cervical. Enfin, il est nécessaire de définir des objectifs clairs, d’établir des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis et de mettre en place des systèmes de suivi des informations. Ces étapes permettent aux responsables des programmes d’évaluer la réussite des actions entreprises et d’identifier les éléments devant être améliorés. Afin d’atteindre les objectifs minimaux d’un programme mis en place dans un environnement aux ressources limitées, il est nécessaire de prendre en compte les éléments suivants : ◗ Utiliser les points forts des systèmes de santé existant dans le pays ou dans la communauté afin d’augmenter les chances de mettre en place le programme sélectionné ; ◗ Obtenir la participation des femmes, de leurs partenaires, des dirigeants de la communauté et d’autres parties prenantes locales, à la conception du programme, à son instauration et à son évaluation ; ◗ Coordonner les actions des services de prévention du cancer cervical à celles des programmes de santé offrant des services connexes et/ou ciblant les femmes d’âge moyen, ou intégrer ces services à ces programmes ; ◗ Identifier les obstacles gênant l’instauration de prestations de services efficaces et tenter de résoudre ces difficultés, avant de lancer le nouveau programme (il peut s’agir, par exemple, de services de cytologie ou de systèmes d’informations inadéquats) ; ◗ Supprimer les réglementations empêchant de faciliter l’accès à ces services, telles que les lois interdisant aux infirmières de pratiquer un test de dépistage ; ◗ Vérifier que les soignants, à tous les niveaux du système de santé, reçoivent une formation appropriée portant sur les mesures de prévention du cancer cervical, notamment sur le conseil ; ◗ Utiliser des stratégies novatrices, testées sur le terrain et respectueuses des cultures des populations afin de dépister les femmes démunies entre 30 et 50 ans ; ◗ Soutenir une recherche ciblée, portant sur les nouvelles méthodes des programmes susceptibles de favoriser l’accès aux services de dépistage tout en diminuant les coûts des programmes. Grâce à des stratégies de prestation de services créatives et aux actions d’un personnel dévoué et compétent, les programmes de prévention du cancer cervical peuvent faire face aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre de services de dépistage et de traitement appropriés et, éventuellement, influer positivement et durablement sur la santé des femmes. Référence 1. Miller AB. Cervical Cancer Screening Programmes : Managerial Guidelines. Geneva : World Health Organization (1992). 2 Le cancer cervical : Planification de programmes de prévention appropriés
