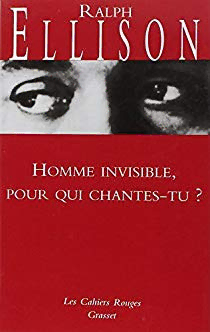
Homme invisible, pour qui chantes-tu? PDF
Preview Homme invisible, pour qui chantes-tu?
RALPH ELLISON Homme invisible, pour qui chantes-tu ? Traduit de l’américain par Magali et Robert MERLE Préface de Robert MERLE Bernard Grasset Paris L’édition originale de cet ouvrage a été publiée simultanément à New York par Random House Incorporated et à Toronto (Canada) par Random House de Canada Ltd., sous le titre : INVISIBLE MAN ISBN 978-2-246-32324-2 ISSN 0756-7170 © 1947. 1948. 1952 by Ralph Ellison © 1982, Ralph Ellison, pour la préface. (All rights reserved under International and Panamerican Copyright Convention) and 1969 by Éditions Bernard Grasset. Préface Ralph Waldo Ellison n’a écrit qu’un seul roman : Invisible Man(1), mais ce roman a suffi pour faire de lui un des premiers écrivains noirs des États- Unis, et un des moins contestés par les critiques, sauf peut-être par les jeunes romanciers de sa propre race. Ceux-ci, comme LeRoi Jones, lui reprochent sa « vision blanche du monde(2) ». Conflit d’attitudes politiques, mais aussi de générations. Ellison a cinquante-cinq ans. LeRoi Jones en a trente-cinq. L’Histoire va vite depuis la dernière guerre. La décolonisation de l’Afrique a multiplié l’impatience des masses noires aux États-Unis. Et les intellectuels qui, comme LeRoi Jones, arrivent à l’âge d’homme, sont beaucoup plus attirés par les thèses séparatistes de Malcolm X ou de Carmichael que par la perspective lointaine – et reculant toujours dans le lointain – d’une assimilation qu’ils ont cessé de considérer comme désirable à force de la croire impossible. Sans aucun doute, Invisible Man, bien qu’écrit par un Noir et mettant en scène un héros noir, n’en reste pas moins un roman blanc par sa fidélité à un schéma narratif traditionnel de la littérature anglo-saxonne et au thème plus spécifiquement américain qui le sous-tend. Invisible Man raconte l’histoire, à la première personne, d’un jeune homme pauvre et méritant qui lutte dans un monde hostile, et qui, de péripétie en péripétie, atteint au succès ou, du moins, à la sagesse. Tom Jones, Roderick Random, Sister Carrie, on reconnaît dans ce personnage qui dit « je » le héros picaresque, et dans son histoire, la success story de l’optimisme américain. Il est exclu que, dans une société qui offre au talent et à l’effort des « possibilités illimitées » (j’admire au passage ce cliché mensonger), un homme jeune, énergique, et, comme disent les Américains, « charismatique », n’arrive pas à se hisser à un degré enviable de l’échelle, et ne connaisse pas, tôt ou tard, outre la sécurité financière, la notoriété et l’amour des femmes. Le héros de Invisible Man n’échappe pas à ce destin, aventures féminines comprises et, on le notera, exclusivement avec des Blanches, signe indubitable de la réussite chez un candidat à l’assimilation. Le fait, cependant, que le héros de Invisible Man soit un Noir, impose à la forme picaresque et à la success story implicite un gauchissement évident. Au contraire du héros picaresque traditionnel, le jeune Noir ne lutte pas à armes égales contre la société. D’entrée de jeu, les dés sont pipés. L’enchère est en monnaie de singe, le chemin du succès mène à une impasse, la sortie est piégée. Car ni l’argent, ni la notoriété, ni l’amour des belles Blanches un peu mûres en quête de sensations primitives ne comblent le héros d’Ellison. C’est là sa noblesse. Le succès individuel ne saurait le satisfaire. C’est la race noire tout entière qui devrait être, en même temps que lui-même, arrachée à son statut minoritaire et promue à l’égalité des chances. Dans le détail et le concret, le gauchissement est plus net encore. Renvoyé, à cause d’un Blanc, de l’université noire où il fait ses études, menant à Harlem une existence précaire à la recherche d’emplois subalternes, les talents d’orateur du héros d’Ellison attirent l’attention d’un parti politique qui fait de lui un permanent rétribué, soumis à la stricte discipline d’un comité. Ce parti, qui se donne à lui-même le nom de Brotherhood (Confrérie), parce que « frères noirs » et « frères blancs » y sont supposés fraterniser, est en fait dirigé par des libéraux blancs. Leurs méthodes dogmatiques et leur stratégie démissionnaire éveillent le doute, la suspicion, et en fin de compte, l’hostilité, chez le jeune militant noir. Au cours d’une émeute qui éclate à Harlem à la suite de l’assassinat d’un de ses amis par la police, le héros décide de se retirer de la scène politique, et réfugié dans une cave, il entre en hibernation. C’est ici que la success story, minée dès le début par le statut minoritaire du héros, achève de perdre son caractère typique. L’histoire ne se termine ni par le succès ni par l’insuccès, mais par une situation ambiguë, sur laquelle nous reviendrons. Ce jeune Noir, Ellison ne nous confie pas son nom, ni même son pseudonyme de militant. Cela veut dire que le jeune homme est à la recherche de sa propre identité. Est-ce là l’habituel cliché américain ? Cliché bien obscur pour qui ne prend pas nécessairement les mots pour des idées. Car votre identité d’état civil, que le veuille ou non le romancier et son omission voulue, vous l’avez en naissant. Et votre identité morale, vous ne l’atteignez vraiment qu’au terme de votre vie, lorsque les jeux sont faits. Bien sûr, la critique outre-Atlantique s’est délectée, chez Ellison, de cet apparent pont aux ânes. « Le héros d’Ellison, écrit William Goyen, incarne la jeunesse, et plus particulièrement, la jeunesse d’aujourd’hui, sa volonté de protester, de découvrir son individualité, son élan personnel. » Rien de moins exact, à mon sens. William Goyen oublie (mais l’oubli est-il ici tout à fait involontaire ?) qu’il s’agît d’un Noir et que sa quête ne saurait donc être, par miracle, étendue – exemplaire et typique – à « tous les jeunes, garçons et filles », des États-Unis. S’il y a quelque chose qui ne se laisse pas gommer, ni transformer en « aventure spirituelle », c’est la pigmentation de la peau et le statut de citoyen de seconde zone dans son propre pays. Sans nom, le héros d’Ellison est aussi sans visage. En un mot, il est invisible. Paradoxe, dit Norman Mailer, « le Noir est certainement en Amérique le moins invisible des hommes ». Raillerie, répond Ellison, à l’égard de la sociologie des années 30 et 40. « On disait alors que les difficultés sociales du Noir provenaient de son trop haut degré de visibilité. » Et Ellison ajoute aussitôt cette phrase, qui nous donne la clef de son apparent paradoxe : « L’ironie, c’est que mon personnage est invisible non seulement pour les autres, mais pour lui-même. » Voilà le grand mot lâché : pour lui-même ! Le Noir, dans une société blanche où il est nié, éprouve nécessairement une grande difficulté à être, et partant, à se voir. L’image du Blanc, telle qu’elle se forme dans sa conscience dès son plus jeune âge, est si irrésistiblement puissante, et si terriblement oppressive, que le Noir est réduit à se voir avec les yeux du Blanc, c’est-à-dire, à se haïr, à se mépriser, à se nier lui-même. Le regard qu’il tourne sur soi est pure négativité. À l’intérieur même de sa conscience, il est néantisé par l’idée que le Blanc se forme de lui, il la lui renvoie comme un miroir docile, il se plie à elle, il se coule dans le moule de la non-existence humaine qu’il lit comme un verdict dans les yeux du Blanc. Michel Fabre, dans son livre pénétrant et généreux sur les Noirs américains(3), énumère les mythes et les symboles par lesquels les romanciers noirs voilent et révèlent à la fois le sentiment de non-existence du Noir : « Dans Dusk of Dawn, Du Bois évoque un monde de fantasmes semblable à celui du mythe platonicien de la caverne. Richard Wright emploie l’image du souterrain dans The Man Who Lived Underground, ou des ombres, dans The Man Who Killed A Shadow, pour montrer à la fois l’irréalité du Noir et l’irréalité pour lui du monde qui l’entoure. Ralph Ellison fait de cette transparence le sujet même de Invisible Man. James Baldwin insiste sur l’anonymat et intitule un recueil d’essais Nobody Knows My Name. Ironiquement, les musulmans noirs ne sont pas loin de reconnaître cet état de fait quand ils substituent à leur nom un simple X. » Dans l’affirmation que son héros est invisible, à ses yeux plaisanterie ou paradoxe, Ellison a mis d’ailleurs plus que ce qu’il a pensé y mettre. On pressent ici, en réalité, des motivations inconscientes et une opération magique. En même temps que de son apparence charnelle, le Noir se débarrasse de sa pigmentation. En devenant invisible, il cesse, miséricordieusement, d’être noir. Il cesse aussi d’être vulnérable, objet de suspicion, de mépris, d’insultes, de haine raciale. En fait, tout le roman dément l’invisibilité du héros. Pour ses interlocuteurs successifs, la couleur de sa peau n’est que trop évidente. Et c’est en tant que Noir qu’il subit tant d’affronts. On remarquera d’ailleurs que l’invisibilité n’apparaît que dans le prologue et l’épilogue, c’est-à-dire, dans les parties hors récit, où Ellison donne carrière à un humour grinçant ou prophétique qui dépasse la réalité. Invisible sur le plan des symboles, mais trop visible sur celui des faits. Il y a là une confusion voulue et une logique qui, à force de logique, débouche sur l’absurde. Je suis noir, j’existe peu et je pèse peu dans la société blanche, moi-même c’est à peine si, nié de toute part, j’ai le sentiment d’exister, donc je suis invisible. La conclusion nie les prémisses dont elle est issue. Le Noir échappe au désespoir de la non-humanité, en échappant par son absence à la condition humaine. En échappant comment ? Mais par les mots, bien entendu. Les mots sont tout-puissants, chacun sait cela depuis l’enfance. On touche la table de sa badine et on dit avec force : je veux que cette vilaine table disparaisse et, bien entendu, elle disparaît. Telle est la puissance du verbe. Je ne reprends pas ici à mon compte le thème raciste de l’infantilisme du Noir, je montre seulement comment l’opprimé se réfugie dans la pensée magique. Le verbe est la première libération. Et le verbe est très important chez Ellison. Peu d’écrivains américains avant lui, de Melville à Faulkner, ont manié la langue anglaise avec tant d’amour, une telle virtuosité. Cette technique n’est pas celle de l’écriture, mais du son. Ellison n’est pas un styliste traçant dans le silence de son cabinet la mosaïque habile d’un paragraphe. On sent partout chez lui le rythme et les cadences de la phrase parlée, même quand la phrase parlée est chargée de réminiscences littéraires ou de souvenirs shakespeariens. Il faut comprendre jusqu’où va, chez ce grand écrivain, l’idolâtrie du verbe, à quelles sources profondes dans le passé d’une race elle puise sa force. L’esclave noir dans le champ de coton, ou le forçat noir cloué à la route qu’il construit, n’ont de libre que la voix. Enchaînés, surveillés nuit et jour par la chiourme et les chiens, la seule évasion possible est vocale. Ils chantent, blues nostalgiques ou spirituals gémissants, et s’évadent de leur condition en se la racontant à eux-mêmes. Le tam-tam des tambours, répercuté de vallée en vallée, a été interdit par les maîtres du coton, car on le soupçonnait de porter des messages qui appelaient à la révolte. Mais le tam-tam est passé dans la voix, et à côté du sens apparent court un sens secret, derrière l’histoire explicite, une forêt de symboles se cache. Le maître blanc écoute, la voix est belle, tout paraît édifiant et naïf, il est charmé, et pourtant, il s’agit, à mi-mot, de sa mort. Dieu est bon. Il enverra le maître blanc en enfer, et le bon Noir, au paradis. Au chant succède le discours, mais toujours scandé, rythmé, supposant les refrains repris en chœur et les répons improvisés des auditeurs. Le prédicateur noir surgit des masses enchaînées, et par la puissance de son verbe, il les libère. À vrai dire, il ne libère encore que ses émotions et les leurs. Mais c’est beaucoup. Le héros d’Invisible Man est un orateur, et on sera frappé par la place qu’occupent dans le livre ses harangues, toutes dramatisées, toutes citées in extenso, et fertiles en conséquences lointaines et pour lui-même et pour les foules qu’elles ont remuées. Surchargé d’émotion véhémente, le discours est ici l’équivalent conceptuel des blues et des spirituals. Dénonciation de la dépossession séculaire du Noir sur la terre américaine, il porte, à qui sait entendre le langage inaudible au-delà des mots entendus, l’annonce symbolique et secrète de la libération. Mais comment entendre cette libération, quand l’Amérique blanche domine « l’hémisphère », et étend même son pouvoir, par gouvernements interposés, dans une partie de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie. Une alternative, à la fois impérieuse et passablement trouble, naît de la situation elle-même ambiguë du Noir dans cette société si puissante. Dans cette société, précisément, il y est sans y être. En principe, il a tous ou presque tous les droits. En pratique, ces droits peuvent être, à tout instant, révoqués. Le vétéran noir qui, dans la deuxième guerre mondiale, a versé son sang sous la bannière étoilée et conquis dans l’armée un grade élevé, peut être, en public, traité de nigger par le premier embusqué venu, par le raté du coin, par le dégénéré des bas-fonds. Le professeur noir d’université qui traverse une ville du Sud au volant de sa Cadillac prend la précaution, nous dit Ellison, de se coiffer d’une casquette pour apparaître comme le chauffeur d’un maître blanc. Eh bien, puisqu’il s’agit de vivre, comment vivre une situation pareille ? Puisqu’elle me met à part, vais-je m’efforcer quand même, à force de patience, de m’intégrer dans cette société qui me refuse ? Ou vais-je pousser jusqu’au bout la séparation que je subis, rejeter à mon tour la société blanche, refuser tout contact avec les Blancs et la vision blanche du monde ? Intégration ou séparation, telle est l’alternative. Dans les déclarations qu’il a faites, après avoir écrit Invisible Man, Ellison s’est prononcé avec force pour l’intégration. Il a été très loin dans cette voie. Il a affirmé qu’il « ne se sentait pas étranger dans son propre pays ». Mieux : « Je suis, dit-il, un écrivain américain qui se trouve être noir. » Il ajoute ces paroles proprement stupéfiantes : « Certes, la couleur est là, mais elle n’est qu’accidentelle. La couleur est un accident. C’est par hasard qu’on nous identifie en tant que Noirs. En réalité, nous sommes blancs comme les autres. » Prise au pied de la lettre, l’affirmation est absurde. Mais son absurdité même trahit une distance ironique entre Ellison et son propos, et sous l’ironie et la provocation qui semblent la sous-tendre, une protestation pathétique. Ce que dit, au fond, Ellison, se réduit à ceci : « Moi, noir ? Ouvrez-moi : sous la peau, je suis blanc. » Ellison est trop bon shakespearien pour n’avoir pas pensé ici au cri magnifique de Shylock : « Je suis juif. Un Juif n’a-t-il pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des sentiments, des passions ? N’est-il pas nourri de la même nourriture qu’un chrétien, blessé des mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes moyens, réchauffé par le même été, refroidi par le même hiver ? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas ? Si vous nous chatouillez, est-ce que nous ne rions pas ? Si vous nous empoisonnez, est-ce que nous ne mourons pas ? » Ainsi, celui qu’une société rejette comme « différent », ramène cette différence à un « accident », et au nom de l’espèce humaine, proclame l’identité de son essence avec ceux qui l’excluent. Mais qui ne voit qu’Ellison a changé ici subtilement de terrain, en glissant, comme Shylock, du social au philosophique ? Si les Noirs sont blancs comme les autres, le problème de l’intégration, bien entendu, ne se pose même pas. Il se pose, pourtant, non pas philosophiquement, mais au niveau des conduites concrètes, dans Invisible Man, et la réponse que lui apporte Ellison est plus ambiguë et plus complexe que l’interview que j’ai citée ne le laisserait croire. Je dirais même qu’elle est bien plus confuse, si je ne craignais de paraître reprocher à Ellison une confusion qui se trouve installée, non en lui-même, mais au cœur de la situation qu’il essaye de vivre. Voici, par exemple, ce personnage inoubliable du roman, le Dr Bledsoe. Directeur de l’université noire où le héros sans nom étudie, il le renvoie. Ce jeune homme a commis à l’égard d’un Blanc important une faute vénielle, mais le Dr Bledsoe n’ignore pas que cette faute, apparemment pardonnée par le Blanc, est pour lui, en fait, impardonnable. Il s’agit donc, pour le Dr Bledsoe, de sacrifier l’avenir d’un jeune homme de sa race aux préjugés inhumains de ses employeurs. Il le fait sans hésitation. On lira avec un sentiment proche de la nausée la scène saisissante où le Dr Bledsoe expose à l’étudiant qu’il expulse sa cynique philosophie. Le Dr Bledsoe s’est à ce point assimilé au système qu’il a parié contre son propre peuple et qu’il s’est fait, contre lui, le complice conscient des Blancs. Mais comment condamner le collabo Bledsoe, sans condamner en même temps l’intégrationnisme ? D’autant que le jeune héros noir du roman fait plus tard, lui aussi, au coude à coude avec les libéraux blancs de la Confrérie, l’expérience de l’intégration et l’expérience tourne mal. Conscient que ses frères de Harlem ont été trahis et sacrifiés par la Confrérie, le héros la quitte à jamais. Le combat au côté des Blancs, même libéraux, n’est pas possible, le dialogue non plus. Reste le nationaliste noir de Harlem, le séparatiste par excellence, Ras l’Exhorteur. Mais le portrait est caricatural. Ras est un personnage fruste, haineux, violent, vitupérateur. L’unique solution, à ses yeux, est la destruction de la société où il vit. Dans les scènes finales d’émeute, il lance ses troupes ridiculement armées de javelots et de boucliers contre les armes perfectionnées de la police. Ainsi, le jeune héros a fait le tour de toutes les attitudes qui sont ouvertes au Noir dans la société américaine, et il les a toutes, tour à tour, rejetées : le bledsoeisme cynique, qui fonde la réussite individuelle sur l’abandon de la solidarité raciale ; la collaboration naïve, idéaliste, avec les Blancs dans un pseudo-combat libérateur qui, en fin de compte, débouche, lui aussi, sur la trahison ; et le séparatisme raciste de Ras, qui culmine dans la violence aveugle et l’absurdité médiévale. Intégration ? Séparation ? La réponse d’Ellison est ambiguë et se situe au niveau du symbole. À la fin du récit, le héros noir, poursuivi au cours de l’émeute par les lyncheurs blancs, tombe par mégarde, par un regard laissé ouvert sur le trottoir. Il disparaît et se retrouve plusieurs mètres plus bas
