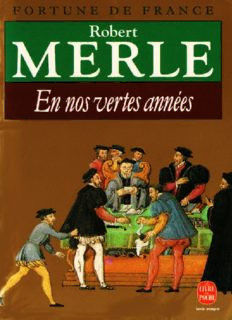
En nos vertes annees PDF
Preview En nos vertes annees
ROBERT MERLE En nos vertes années Fortune de France II ÉDITIONS DE FALLOIS CHAPITRE PREMIER Ha certes ! Si enflammé que je fusse à galoper en ce mois de juin avec mon gentil frère Samson et notre valet Miroul par les montées et les dévalades des grands chemins de France, cependant j’avais, par bouffées, le cœur mordu de laisser si loin derrière moi dans le Sarladais la baronnie de Mespech. Peu s’en fallait que, chevauchant, ne me vînt larme à l’œil chaque fois que je me ramentevais le grand nid crénelé où j’avais éclos et mis mes plumes, protégé des troubles du temps par ses remparts, mais plus encore par la bravoure de mon père, de l’oncle Sauveterre, de nos soldats, car notre dicton périgordin dit vrai : Il n’est bons murs que de bons hommes. Mais quoi ! Nos quinze ans venus, le latin bien enfourné dans nos têtes (où langue d’oc et français déjà voisinaient), notre valeur au surplus bien prouvée dans le combat de la Lendrevie, ne fallait-il pas nous tirer enfin du chaud duvet de notre Barberine, quitter, comme j’aimais à dire, nos maillots et enfances, et puisque nous avions le malheur d’être cadets (et mon bien-aimé Samson, par surcroît, bâtard), pousser plus avant nos études, et ainsi que l’avait décidé mon père, en Montpellier. En cette bonne ville, il avait lui-même étudié en la fleur de son âge. Elle lui était fort chère, et il tenait que son collège de médecine, où Rabelais avait soutenu ses thèses, passait tous les autres, Paris compris, par l’audace, la variété, et les nouveautés de son enseignement, brillant, disait-il, en cette deuxième partie du siècle, d’un éclat plus vif qu’au siècle précédent, l’école de Salerne. Cependant, bien long et périlleux était le chemin de Sarlat à Montpellier, surtout pour trois huguenots qui n’avaient point cinquante ans à eux trois, et voyageaient en des temps encore si troublés, au sortir des guerres où les nôtres et les catholiques s’étaient si cruellement déchirés. Certes, une sorte de paix régnait maintenant entre les deux partis, mais grondante et rechignée. Les inquiétudes des nôtres avaient flambé derechef en 1565, lors de l’Entrevue de Bayonne, où Catherine de Médicis, s’entretenant en secret avec le Duc d’Albe, s’était, selon la rumeur, dite prête à troquer le mariage de sa fille Margot et de Don Juan d’Espagne contre le sang des huguenots français. Mais Philippe II avait en fin de compte refusé, non sans hauteur, d’allier de nouveau son sang avec le trône de France. Pis même : l’année suivante, le Roi très catholique, irrité de ce que des Français nichassent si près de ses possessions des Amériques, et dans son dépit oubliant tout soudain ses belles évangiles, avait fait massacrer par surprise nos colons bretons de Floride. Catherine de Médicis en avait conçu un grand courroux, au point que l’Espagnol avait perdu quelque peu de son crédit à la Cour de France, et n’osait plus, en son zèle papiste, réclamer si haut l’assassinat de nos chefs protestants et, pour la masse de nos frères, l’exil ou le bûcher. Ces sanglants projets écartés, à tout le moins pour un temps, la fortune de France osait à nouveau sourire. La paix paraissait quelque peu gagner, les plus acharnés papistes parmi les sujets du Roi perdant cœur à n’être plus soutenus par l’Espagnol, et les catholiques modérés retrouvant l’espoir de chercher avec les nôtres des accommodements. Encore fallait-il compter, quand on chevauchait par le royaume, avec les gueux qui, dans le désordre des guerres civiles, infestaient les forêts, rançonnaient les carrefours, occupaient les ponts pour y lever péage, et non contents de larronner, commettaient, l’arme au poing, des excès infinis. Certes, exercés aux armes dès notre âge le plus tendre – la dernière tétée des beaux tétons de Barberine ayant à peine passé le nœud de notre gorge –, en outre, armés en guerre pour la circonstance, le morion sur le chef, le corselet défendant la poitrine, le braquemart nous battant la jambe, la dague pendant à la ceinture, les crosses de nos pistolets émergeant des fontes de nos selles, et nos arquebuses portées sur le cheval de bât que menait Miroul par sa longe, nous pensions, Samson et moi, avoir peu à redouter de ces méchants. Mais Miroul qui, tout jeune qu’il fût, avait déjà connu les traîtrises des grands chemins, nous répétait, comme mon père l’avait fait, que le salut n’était point dans un combat où il ne servirait à rien de vaincre si l’un de nous était navré, mais dans la fuite, où la vélocité supérieure de nos montures nous assurerait l’avantage. Conseil de poids, car prudence, chez Miroul, n’était point fille de lâcheté. Fluet, mais agile au point de grimper le long d’un mur comme mouche avec ses pattes, et son coup de pique partant dans la lutte aussi roide et vif que carreau d’arbalète, il valait trois soldats à lui seul. Qu’on ne me croie pas ici gasconnant : je ne dis que le vrai. Et d’ailleurs, on le verra bien. Quant au moment de ce voyage, il pourra surprendre, étant si précoce, les cours à Montpellier ne commençant qu’à la [1] Saint-Luc , mais bien avais-je compris que l’intention de mon père, en le décidant si tôt, était de me guérir de la grande mélancolie où j’étais tombé après la mort de la petite Hélix, ma sœur de lait. Elle s’était, un mois plus tôt, endormie dans le Seigneur après de grandes souffrances, en la fleur de ses dix- neuf ans. Or je l’aimais de fort grande amitié, malgré la modestie de son état et les sourcillements de mon aîné François, resté, lui, pour l’heure, à l’abri de nos murs, en attendant de devenir Baron quand le Créateur rappellerait mon père à lui. Et attendre, François le pouvait, certes, et de longues années encore, Dieu merci, tant mon père, à cinquante ans passés, était vif et vigoureux, ayant enlevé, un an plus tôt, Franchou – la chambrière de sa défunte épouse – dans le faubourg de la Lendrevie, aux portes de Sarlat infecté de peste, et l’épée à la main, faisant face, Samson et moi à ses côtés, à une bande de gueux sanguinaires. Huguenot, je l’étais, certes, mais je l’étais moins que mon frère Samson, point nourri comme lui, dès le premier souffle, dans la religion réformée, ma mère m’ayant élevé dans la religion romaine. À son lit de mort – converti que j’étais pourtant, depuis l’âge de dix ans, à la nouvelle opinion, par mon père et selon une pression qui ne fut pas petite –, ma mère m’avait baillé une médaille de Marie, exigeant de moi le serment de la porter jusqu’à ma propre fin. Ainsi, professant la religion réformée, je portais autour du col, fidèlement, l’image et comme le symbole de la religion catholique. Est-ce pour cela que les familiarités où la petite Hélix m’avait, de son vivant, entraîné en la douceur de nos nuits amicales, me paraissaient beaucoup moins damnables qu’elles ne seraient apparues à mon demi-frère Samson dont la grande beauté s’alliait à une vertu farouche, encore qu’il fût la preuve vivante, lui qui avait été conçu hors mariage, que mon père, tout huguenot qu’il fût, pouvait errer hors des droits chemins, sans que le Seigneur visitât de sa colère le fruit de son péché – ni d’ailleurs, le pécheur lui-même, tant étaient grandes la prospérité de Mespech et les richesses que la bonne économie huguenote et l’adroit ménage de nos champs y avaient accumulées. Mon père n’avait voulu que nous passions, pour gagner Montpellier, par les montagnes du centre, où les embûches des gueux eussent été si faciles. Il avait préféré qu’après Cahors et Montauban nous prenions par Thoulouse, Carcassonne et Béziers, où la route courait en plaine et, bien qu’assurément plus longue, était aussi plus sûre, en raison de la grande affluence des gens qui y chevauchaient ou y menaient charrois. Cependant, au milieu à peine de notre chemin, logeant dans un faubourg de Thoulouse, à l’auberge des Deux-Anges, nous apprîmes par l’alberguière (une accorte veuve) que quinze jours plus tôt, un convoi marchand, pourtant bien défendu par trois hommes d’escorte, s’était fait piller et massacrer entre Carcassonne et Narbonne par une forte bande qui avait ses repaires dans les monts des Corbières. Cette fâcheuse nouvelle nous donna fort à penser, et dans la chambre des Deux-Anges, où nous étions, Samson et moi, retirés – Miroul ayant son lit dans un petit cabinet attenant –, nous en devisâmes, assis tous trois en rond sur nos escabelles, Miroul un peu en retrait et tenant sur ses genoux sa viole dont il tirait entre-temps des sons lugubres pour accompagner nos alarmes. Car nous ne savions à quel saint, diable incube ou succube nous vouer, n’osant point poursuivre notre chemin en tel imminent péril, et moins encore en écrire à notre père, dont la réponse ne pourrait avant quinze jours nous parvenir. — Quinze jours en l’auberge des Deux-Anges ! s’écria Samson en secouant ses beaux cheveux de cuivre. Ce serait ruine de bourse, oisiveté coupable, tentation du malin… Ici, Miroul, me regardant, pinça trois fois sa corde pour souligner le triple danger qui guettait en ces lieux nos vertes années. Et je fus étonné, quant à moi, que même au candide Samson, il n’eût point échappé que les brunes et rondelettes chambrières qui servaient dans l’auberge en nombre surérogatoire n’étaient point de mine à se modeler sur les deux anges de l’enseigne, lesquels, à vrai dire, n’avaient guère mérite à leur vertu, étant découpés dans du fer. J’allais répondre à cette remarque quand, sur la dernière note de Miroul, éclata tout soudain dans la rue de la Mazelerie, où l’auberge était sise, un fort grand tumulte de sabots de chevaux, de jurons et de cris. Je tirai vers la fenêtre (il me fallut l’ouvrir pour voir, car elle était, comme toutes celles de la rue, garnie non de verre, mais de papier huilé). Samson m’y suivit, et Miroul, sa viole à la main, et dans le soir tombant nous vîmes, sautant sur le pavé luisant du haut de grands chevaux bais à grosses croupes et longues queues, une bonne cinquantaine de voyageurs, hommes et femmes, en vêture poussiéreuse, mais de vive couleur et bonne étoffe, armés qui d’une arquebuse, qui d’une pistole, qui d’une épée, les donzelles et commères ayant grande dague en leur mœlleuse ceinture, et portant, contre le soleil des provinces du Midi, des couvre-chefs aussi grands que des boucliers. Les uns et les unes étaient d’âge et de condition divers, mais fort grands, l’épaule robuste, le cheveu paille, l’œil bleu, d’aucuns et d’aucunes toutefois, comme je le remarquais, d’un tout autre type, petits, trapus, noirs de peau et de poil, mais tous et toutes, blonds et bruns, si contents de démonter et de trouver gîte, qu’ils criaient et clabaudaient à oreilles étourdies, la trogne rouge, la voix enrouée, riant à gueule bec, et dans la liesse de se retrouver à terre, se poussant, se pastissant, s’accolant, se donnant fortes tapes sur épaules et sur cul, ou encore hurlant pour s’entr’appeler d’un bout à l’autre de la rue, et s’égosillant à se rompre le gargamel – leurs grands chevaux, cependant, fumant de sueur, tapaient du sabot et, secouant leurs blondes crinières, hennissaient après leurs avoines à vous tympaniser. Bref, gens et bêtes menaient, en cette rue de la Mazelerie, tel tapage et inouï vacarme que vous eussiez cru une armée de croquants révoltés assiégeant la Maison de Ville. Tout le bon peuple thoulousain du faubourg était, comme nous-mêmes, en poste aux fenêtres, béant, muet, l’œil quasi sorti de l’orbite, et l’ouïe fort étonnée, car les nouveaux venus braillaient une étrange sorte de parladure, où des mots français (mais non point parlés dans l’accent pointu de Paris) se mêlaient à un jargon où pas un fils de bonne mère n’entendait goutte. La troupe, enfin, s’engouffra en infinis bousculade et tumulte dans l’auberge, tandis que les valets accouraient pour se saisir des chevaux et les mener aux écuries, non sans faire des cris d’admiration de la grosseur de leurs poitrails et de la puissance de leurs croupes. Sous nos pieds, bien que nous fussions au deuxième étage des Deux-Anges, la hurlade continuait, et si forte qu’on eût dit que les murs branlaient. On frappa un coup à notre porte, et Samson et moi étant fort occupés à la fenêtre à regarder les chevaux, je dis à Miroul d’ouvrir. Ce qu’il fit, sa viole à la main, car il ne la quittait mie, même en sa couche. Apparut alors – je la vis du coin de mon œil senestre tout en contemplant les montures – l’alberguière elle-même, brune, vive et trémoussante, fort bien vêtue d’une cotte jaune et d’un corps de cotte lacé de même couleur, que poussait de l’intérieur un parpal si beau, si rond et si remuant que c’était bien malice de l’exposer là si on ne voulait point qu’on le palpât. — Mon joli drôle, dit l’alberguière en son thoulousain à Miroul, es-tu pas le valet de ces beaux gentilshommes du Périgord que je vois musant à la fenêtre ? — Oui-da ! dit Miroul, pinçant une corde courtoise de sa viole. Je suis à leur service, et tout dévoué au vôtre, à l’occasion, ma bonne hôtesse, reprit-il, pinçant alors une autre corde dont c’est merveille ce qu’il lui fit dire en complément de son œillade. — Foi de chrétienne ! dit l’alberguière en riant, tu es bien fendu de gueule, à ce que je vois, valet, et ta musique aussi. Comment te nomme-t-on ? — Miroul, à votre service, dit notre valet qui, pinçant sa viole, chantonna derechef à mi-voix : Miroul les yeux vairons ! Un œil bleu, un œil marron ! Mais ceci, hélas, me serra fort le cœur, car c’est ainsi que la petite Hélix accueillait Miroul dans les rémissions de sa longue agonie, quand il venait, à ma prière, sa viole en main, tâcher de lui faire oublier les flammes de son pâtiment. Toutefois je refoulai aussitôt ce souvenir dans la gibecière de ma mémoire. C’était en avant de moi désormais, et non pas en arrière, que je voulais regarder. — Miroul ! dit l’hôtesse en battant du cil et en se trémoussant, je n’ai guère fiance en ce vairon-là. Car si l’œil bleu est sage, l’œil marron est coquin. C’était si bien badiné que je voulus y mettre mon grain, attiré au demeurant par cette belle garce comme la limaille par l’aimant. — Ma commère, dis-je en me retournant tout à fait et venant à elle d’un pas vif, le dos droit et les mains aux hanches, quoi que tu nous demandes en aide, secours, ou service, tu l’auras assurément sur ta belle mine et gracieuse charnure. — Voilà propos, dit-elle, qui plus est délectable quand plus souvent il est redit. — Je te le redirai à toute heure, hôtesse, si tu le veux, et de jour et de nuit. Mais l’alberguière, qui pensait sans doute que nous étions allés trop vite et trop loin dès le premier mot, ne répondit pas à cela autrement que par une révérence qui, pour dire le vrai, eût pu donner du chagrin à un esprit austère. Car elle dut, quand elle se releva, remettre de ses doigts légers ses jolis avantages au douillet logis de son corps de cotte. — Moussu, dit-elle avec un air de feinte confusion, venons- en à nos affaires : Voici que nous arrivent au débotté cinquante pèlerins de Normandie qui se rendent saintement à Rome sous la conduite d’un puissant Baron et d’une demi-douzaine de moines. — Je les ai ouïs, je crois ! dis-je en riant. — Hélas ! dit l’alberguière, ce n’est pas là le pire ! Car pour les loger, il m’en faudra mettre quatre par lit, et dans ce lit-ci – dit-elle en désignant le nôtre – vous n’êtes que deux. Mon noble Moussu, accepteriez-vous pour cette nuit deux autres compagnons de lit ? — Hommes ou femmes ? dis-je avec un sourire. — Hommes ! dit Samson d’un air grave en quittant la fenêtre et en tirant vers nous. L’alberguière le considéra un instant en silence tandis qu’il se tenait debout devant elle en sa virile beauté et vigoureuse symétrie de corps. Elle poussa alors un profond soupir, car bien elle sentait quel ange de Dieu c’était là, et qu’elle n’en pourrait rien tirer, elle qui aimait tant les vifs. — Ce sera donc des hommes, dit l’alberguière avec un nouveau soupir qui fit passer une petite houle dans son corps de cotte, et qui me fit penser qu’elle eût peut-être cédé son lit aux pèlerins pour venir dans le nôtre. — Des hommes, mais point des moines ! dit Samson avec son charmant zézaiement, mais non sans roideur. À cela, l’alberguière s’émut fort et changea de visage : — Par saint Joseph, la Sainte Vierge et tous les saints ! s’écria-t-elle, son œil brun s’abrunissant, seriez-vous de ces pestiférés hérétiques et suppôts du Diable qui ne peuvent souffrir auprès d’eux la présence des hommes de Dieu ? — Non point, ma commère ! dis-je hâtivement, sachant combien, depuis la victoire de Montluc, les huguenots étaient, à Thoulouse, suspects et pourchassés, même par le populaire. Mon frère ne l’entend point ainsi ! Mon frère craint que ces
