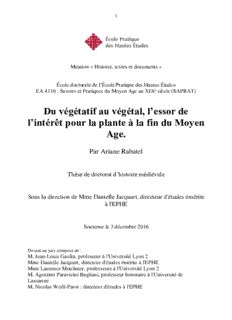
Du végétatif au végétal, l’essor de l’intérêt pour la plante à la fin du Moyen Âge PDF
Preview Du végétatif au végétal, l’essor de l’intérêt pour la plante à la fin du Moyen Âge
1 Mention « Histoire, textes et documents » École doctorale de l’École Pratique des Hautes Études EA 4116 : Savoirs et Pratiques du Moyen Age au XIXᵉ siècle (SAPRAT) Du végétatif au végétal, l’essor de l’intérêt pour la plante à la fin du Moyen Age. Par Ariane Rabatel Thèse de doctorat d’histoire médiévale Sous la direction de Mme Danielle Jacquart, directeur d'études émérite à l'EPHE Soutenue le 3 décembre 2016 Devant un jury composé de : M. Jean-Louis Gaulin, professeur à l'Université Lyon 2 Mme Danielle Jacquart, directeur d'études émérite à l'EPHE Mme Laurence Moulinier, professeure à l'Université Lyon 2 M. Agostino Paravicini Bagliani, professeur honoraire à l'Université de Lausanne M. Nicolas Weill-Parot : directeur d'études à l'EPHE 2 RESUME L’étude des plantes à la fin du Moyen Age n’a pas d’autonomie. Elle s’intègre à une approche philosophique, qui consiste à les situer dans l’échelle de la Création, ou à une démarche plus utilitaire, en lien avec la médecine ou l’alimentation. Les encyclopédies du XIIIᵉ siècle ou le De Vegetabilibus d’Albert le Grand révèlent un intérêt multiple pour la flore, les plantes étant considérées à la fois pour l’état végétatif qu’elles incarnent et pour les profits qui peuvent en être tirés. Elles ne sont pas un sujet en soi mais donnent lieu à des réflexions qui amènent à mieux les connaître. Dans les herbiers, l’étude des différentes espèces végétales a pour but d’en maîtriser les propriétés. Or, le besoin d’identifier les plantes décrites par les sources compilées conduit à une meilleure connaissance des spécimens végétaux. De même, les dictionnaires de synonymes, les manuels d’agronomie, les traités d’apothicaires et de diététiques, ou les encyclopédies qui reprennent les Problèmes d’Aristote, témoignent d’une certaine spécialisation du discours sur la plante. Celle-ci est de moins en moins envisagée dans un contexte global. L’intérêt pour le végétatif décline, tandis que chaque espèce végétale, dans ce qu’elle a de spécifique, trouve de plus en plus sa place. C’est le cas également dans l’iconographie, les dessins de plantes gagnant en naturalisme. Ces approches multiples de l’univers végétal, bien qu’elles ne se croisent pas, participent de l’essor de la botanique car la plante est envisagée sous différents angles de vue qui permettent d’en avoir une perception riche et plurielle. FROM VEGETATING TO VEGETABLE, THE GROWING INTEREST IN PLANTS AT THE END OF THE MIDDLE AGES. Plant study at the end of the Middle Ages doesn’t operate as an independent unit. It belongs rather to a philosophical approach which consists of placing plants on the scale of the Creation, or confining them to a useful function related to medicine or food. Thirteenth century encyclopaedias or Albert the Great’s De Vegetabilibus reveal the multiple interests in flora whereby plants are considered both for their vegetating state and for the benefits to be gained from them. While not a subject in their own right, plants trigger thoughts which help us to better understand them. In herbaria, the study of different plant species aims at mastering their properties. Thus the need to identify the plants described in such classifications leads to an improvement in our knowledge of plant specimens. Furthermore, 3 dictionaries of synonyms, agronomy manuals, apothecaries’ treatise or encyclopaedia revisiting Aristotle’s Problems, all bear witness to a certain specialisation in the field of plant study. Perceiving plant life in a global context becomes less common. A declining interest in contemplating plants as a vegetating species, shifts to considering each plant with its specific characteristics. The same observation can be made in plant iconography with the images of plants becoming increasingly realistic. While they never cross paths, these multiple approaches to the plant world contribute to the rise in botany with the plant being examined from different angles affording a rich composite perception. MOTS-CLEFS : botanique, état végétatif, herbier, substance végétale KEY WORDS: botany, vegetating state, herbarium, vegetable matter 4 REMERCIEMENTS Je tiens à remercier avant tout Mme Jacquart pour son soutien, ses remarques et ses nombreux conseils. Elle m’a guidée tout au long de mes années de préparation. Je remercie également les collègues qui m’ont apporté leur éclairage sur certaines questions et tous ceux qui m’ont encouragée dans mon travail, famille et amis. 5 TABLE DES MATIERES Introduction. Page 7 I- LA PLANTE COMME INCARNATION DE L’ETAT VEGETATIF CHEZ ALBERT LE GRAND ET LES ENCYCLOPEDISTES DU XIIIᵉ SIECLE. Page 13 I-1- L’étude des plantes intégrée dans une somme de connaissances. Page 13 I-1-a- La botanique ne constitue pas une discipline indépendante. Page 13 I-1-b- L’influence des sources : une compilation de savoirs sur les plantes. Page 22 I-1-c- Des formes d’émancipation ? Page 36 I-2- L’assimilation d’un savoir hérité : quels regards sur les végétaux ? Page 50 I-2-a- Livres, chapitres, tables alphabétiques : des ouvrages plus pratiques. Page 50 I-2-b- L’influence majeure d’Aristote sur la réflexion concernant la plante en général. Page 56 I-2-c- L’étude de la diversité chez les plantes ouvre-t-elle la voie à une démarche scientifique ? Page 63 I-3- Une connaissance de la plante qui n’a pas d’autonomie. Page 89 I-3-a- L’observation de la morphologie de la plante pour en comprendre les causes. Page 82 I-3-b- La physiologie végétale rattachée à la physique. Page 145 I-3-c- Les catégories de plantes, une hiérarchisation aux diverses inspirations. Page 165 II- UNE APPROCHE UTILITAIRE DE LA PLANTE. Page 183 II-1- Les herbiers du XIIIᵉ siècle : connaître la plante pour se soigner. Page 183 II-1-a- Une connaissance de la plante tributaire de sources médicales. Page 183 II-1-b- Une description de plantes au carrefour de plusieurs influences. Page 200 II-1-c- Une expérience des plantes plus personnelles chez Albert le Grand et Rufinus ? Page 227 II-2- Les premiers jalons de la systématique. Page 247 II-2-a- La description de la plante : un outil mais pas un but. Page 247 II-2-b- Distinguer les espèces. Page 257 II-2-c- Reconnaître la plante pour mieux la connaître ? Page 271 II-3- Les traités d’agronomie des XIIIᵉ et XIVᵉ siècles : connaître la plante pour se nourrir. Page 303 6 II-3-a- Chez Albert le Grand : comprendre les propriétés de la plante pour la cultiver. Page 303 II-3-b- Chez Pierre de Crescens : la culture de la plante au cœur du discours. Page 312 II-3-c- Le succès des ouvrages d’agronomie et d’économie domestique à la fin du Moyen Age. Page 330 III- DE NOUVEAUX REGARDS SUR LA PLANTE ET UNE SPECIALISATION DES DISCOURS A LA FIN DU MOYEN AGE. Page 340 III-1- Un nouvel intérêt pour les faits particuliers. Page 340 III-1-a- Les Problèmes d’Aristote : le singulier mis en exergue. Page 340 III-1-b- Le commentaire des Problèmes par Pietro d’Abano et la traduction et le commentaire d'Evrart de Conty. Page 349 II-1-c- Des commentateurs qui s’adaptent à leur lectorat. Page 362 III-2- Des représentations plus réalistes : la plante comme sujet. Page 378 III-2-a- Les herbiers et les Tacuina sanitatis illustrés. Page 379 III-2-b- Les illustrations de plantes décoratives et les premières gravures. Page 404 III-2-c- La flore sculptée. Page 413 III-3- La plante particulière trouve de plus en plus sa place. Page 417 III-3-a- Les dictionnaires de synonymes : un intérêt centré sur l’identification de la plante. Page 418 III-3-b- Les traités d’apothicaires et les manuels de diététique : la plante, une substance à reconnaître. Page 441 III-3-c- D’une spécialisation du discours à une spécialisation de l’étude des plantes. Page 460 Conclusion. Page 468 Sources. Page 475 Bibliographie. Page 506 Annexes. Page 577 - Reproductions d’illustrations du ms Egerton 474. Pages 577-580 - Reproduction de l’illustration de la camomille du ms Egerton 4040. Page 581 - Reproduction d’une enluminure du ms 413 de la Bibliothèque municipale de Laon. Page 582 - Reproductions de gravures de l’Herbarius latinus et du Jardin de Santé. Pages 583-584 7 INTRODUCTION Etudier la façon dont la plante est perçue à la fin du Moyen Age invite à explorer de nombreux domaines et nécessite de croiser différents types de sources, qu’elles soient écrites ou iconographiques. Les plantes font partie du quotidien des hommes. Elles constituent leur environnement et occupent une part importante de leur alimentation. On peut alors s’interroger sur l’expérience qu’en ont les sociétés médiévales de l’Occident, en examinant à la fois le type et le degré de leurs connaissances, tout ayant conscience que celles-ci ne sont pas les mêmes selon les individus et les régions. Les sources ne peuvent pas représenter la pluralité des rapports que les sociétés de la fin du Moyen Age entretiennent avec les plantes. Elles n’expriment que certains points de vue. Il convient donc de les multiplier pour tenter d’avoir une approche globale de la perception qu’on en a. Il est nécessaire de s’intéresser à la fois à l’expérience des plantes qu’ont les hommes du Moyen Age, dans leur vie courante, mais aussi de voir dans quelles perspectives elles sont intégrées aux travaux écrits et à l’iconographie. Dans les préoccupations communes qui semblent émerger, s’impose la nécessité de reconnaître les plantes, de les identifier grâce à leur apparence, à des comparaisons, ou à quelques traits distinctifs comme leur goût ou leur odeur. Il est alors difficile d’établir ce qui relève de connaissances transmises et ce qui résulte d’une expérience acquise sur le terrain, par l’observation. Les auteurs de traités botaniques étant largement tributaires d’un savoir hérité, ils n’enrichissent pas forcément les informations compilées de leur vécu, préférant s’en remettre à l’autorité. Les sources étudiées ne sont donc pas toujours révélatrices de ce que savent les auteurs de la fin du Moyen Age sur les végétaux, à plus forte raison que leur travail n’a pas pour but de dresser l’inventaire de leur diversité. De plus, reconnaître une plante n’implique pas de la connaître. L’identifier, ce n’est pas en comprendre les propriétés ou le fonctionnement. Il faut donc interpréter les informations livrées sur le monde végétal, d’autant plus que l’intérêt pour les plantes n’est pas seulement lié à ce qu’elles peuvent apporter à l’homme, mais aussi à ce qu’elles incarnent. Elles sont porteuses de symboles et de représentations mentales. Il convient de multiplier les points de vue, pour déceler à la fois les récurrences et les singularités dans l’attention qu’on leur porte. Plusieurs études ont été menées sur les plantes ces dernières années. Les textes réunis par Agostino Paravicini Bagliani dans le volume de Micrologus’ Library paru en 2009 et consacré au monde végétal, couvrent des sujets variés qui montrent combien les végétaux peuvent donner lieu à de multiples questionnements. Les volumes du Cahier du Léopard d’Or, 8 collection dirigée par Michel Pastoureau, parus en 1993 et 1997 sur les thèmes de l’arbre et des jardins, ainsi que l’ouvrage collectif Le monde végétal, XIIe-XVIIe siècles : savoirs et usages sociaux, paru en 1993 sous la direction d’Allen J. Grieco, d’Odile Redon et de Lucia Torgiorgi Tomasi, soulignent que l’étude des plantes peut s’envisager dans une approche thématique et diachronique. De même, les travaux de Laurence Moulinier, de Jean-Louis Gaulin ou, avant eux, de Jerry Stannard sur la botanique d’Albert le Grand incitent à analyser plus particulièrement le De Vegetabilibus, source fondamentale pour étudier la botanique au Moyen Age. Il serait trop long de dresser l’inventaire de toutes les études qui ont été ménées sur un auteur ou un type d’ouvrage s’intéressant aux plantes. On peut citer, entre autres, les travaux de Laurence Moulinier sur Hildegarde de Bingen, ceux de Jean-Louis Gaulin sur Pierre de Crescens, l’édition critique du livre XVII du De Proprietatibus rerum de Iolanda Ventura. Michèle Goyens, de son côté, s’est intéressée au lexique des plantes dans la traduction des Problèmes d’Aristote par Evrart de Conty et Joëlle Ducos aux traductions en vernaculaire. Nombreuses sont les publications qui abordent les plantes dans une approche thématique, comme par exemple le travail de Minta Collins sur les herbiers du Moyen Age, celui de Denise Jalabert sur la flore sculptée, celui de Jean-Pierre Bénézet sur la pharmacie, les recherches de Marilyn Nicoud sur la diététique, ou les nombreux travaux sur les jardins. Mon DEA, sous la direction de Jacques Verger, portait sur « les représentations du monde végétal dans les œuvres littéraires du XIIe au XIVe siècles ». En poursuivant sur un doctorat, j’ai souhaité étudier plus en profondeur la question de la perception des plantes, encouragée par la multiplicité des domaines à explorer. J’ai voulu multiplier les points de vue pour essayer d’avoir une vision d’ensemble de ce que les hommes de la fin du Moyen Age savent des plantes et de ce à quoi ils les associent. Si les écrits et l’iconographie de cette période témoignent d’une connaissance riche et plurielle de la plante, celle-ci n’est pas étudiée pour elle-même. L’intérêt qu’elle suscite suit deux tendances héritées de l’Antiquité. Elle peut être envisagée en relation avec la philosophie naturelle ou dans une démarche plus utilitaire, en lien avec la médecine, l’alimentation ou l’ornementation. Les auteurs de traités ou de sections botaniques ne perçoivent pas la plante comme une entité à part, pouvant être l’objet d’une étude indépendante. Elle incarne un état ou présente une utilité pour l’homme. Par conséquent, les sources à consulter se rattachent à différents domaines qui n’ont pas forcément de liens entre eux. A la fin du Moyen Age, on s’interroge sur l’état végétatif ou sur les propriétés de certaines substances végétales. Une première approche des plantes consiste à les situer dans le 9 monde vivant. Cette façon d’appréhender la botanique est notamment présente dans les ouvrages de type encyclopédiques du XIIIe siècle. Abordées parmi de nombreux autres sujets, les plantes sont intégrées à l’ensemble des connaissances sur la nature. Elles incarnent un état végétatif. En effet, la réflexion sur la nature des végétaux et sur l’âme qui les anime est déterminante après la redécouverte d’Aristote. Les sections du Speculum naturale de Vincent de Beauvais et du De proprietatibus rerum de Barthélémi l’Anglais dédiées aux végétaux sont des exemples significatifs pour mesurer la place qu’occupe la plante dans les encyclopédies du XIIIe siècle. Ils prouvent que son étude n’est pas envisagée de façon autonome. De ce point de vue, le De Vegetabilibus d’Albert le Grand, achevé au plus tard en 1260, est original, car ce traité de botanique théorique, complété d’un herbier et d’un livre d’agronomie, constitue un ensemble indépendant, à l’image des livres d’Albert le Grand sur les animaux et sur les minéraux. On peut ainsi se demander si le De Vegetabilibus marque un premier jalon dans l’émancipation de la botanique. Que ce soit dans ce traité ou dans les encyclopédies, les connaissances sont largement puisées chez les auteurs antiques, Pline, Dioscoride ou le pseudo-Aristote, ainsi que dans les Etymologies d’Isidore de Séville. L’influence des sources détermine donc le type de regard porté sur les plantes. Les auteurs du XIIIe siècle croisent différents points de vue dans leurs ouvrages. Cela se perçoit notamment dans le fait que les considérations générales sur les plantes sont généralement suivies d’herbiers, voire de traités d’agronomie. Il faut donc s’interroger sur les données que les auteurs de la fin du Moyen Age retiennent des sources qu’ils compilent. Il est également nécessaire de mesurer comment ils s’approprient ces connaissances, en les organisant, en les triant, ou en les complétant. Leur préoccupation n’est généralement pas de mettre en doute l’information compilée, bien qu’Albert le Grand puisse faire preuve d’esprit critique, mais de se concentrer sur le tri des informations. C’est dans ce travail de sélection et d’organisation que les auteurs peuvent témoigner de leur représentation des plantes, par les choix qu’ils opèrent. Ils apportent également leur contribution par leurs commentaires. C’est particulièrement vrai d’Albert le Grand dont les cinq premiers livres du De Vegetabilibus, qui s’intéressent aux plantes en général, sont un commentaire du De plantis de Nicolas de Damas, ouvrage du IIe siècle attribué à Aristote. Les prises d’initiatives d’Albert le Grand s’observent dans ses nombreuses digressions. Vincent de Beauvais et Barthélémi l’Anglais ajoutent également certaines gloses qui, comme dans le De Vegetabilibus, cherchent à rendre le texte d’origine plus compréhensible. Ces contraintes, que ce soit celles de la compilation ou de l’accessibilité du savoir, ont une incidence sur le type d’informations transmises au sujet des plantes. Les 10 ouvrages de type encyclopédique devraient donc permettre de mesurer à la fois comment elles sont perçues dans une vision d’ensemble de la Création, et quelles données les concernant les auteurs estiment importantes à retenir. On peut aussi se questionner sur les non-dits, que ce soit les informations occultées ou les allègements d’extraits compilés. Sont-ils négligés car ils ne semblent pas importants aux yeux des compilateurs ou estiment-ils qu’il n’est pas nécessaire de les rappeler car ce sont des savoirs déjà intégrés par leurs lecteurs ? A la fin du Moyen Age, l’intérêt pour les plantes est surtout porté sur l’utilisation que l’homme peut en faire pour se nourrir, se soigner, ou pour d’autres usages pratiques. Dans l’héritage des sources antiques et arabes, les traités qui évoquent les plantes sont généralement liés à la médecine, à l’agronomie ou à la diététique. Cette démarche empirique laisse entendre que l’objectif de ce type d’ouvrage n’est pas de connaître les plantes pour ce qu’elles sont, mais pour les bienfaits ou les risques qu’elles représentent pour l’homme. En effet, à l’époque médiévale, l’étude des plantes particulières a essentiellement pour but d’en maîtriser les propriétés. Elle se présente souvent sous la forme d’herbiers, série de descriptions de plantes médicinales, voire de substances minérales et animales, disposées généralement dans l’ordre alphabétique. Chaque notice de plante comporte un rappel de l’étymologie de son nom, parfois des synonymes, une brève description de celle-ci, et l’indication de ses propriétés. Les herbiers de la fin du Moyen Age, notamment le livre VI du De Vegetabilibus, les herbiers qui figurent dans les encyclopédies de Barthélémy l’Anglais et de Vincent de Beauvais, et l’herbier de Rufinus, sont largement tributaires de sources antérieures. La sélection des plantes qu’ils décrivent dépend des autorités compilées, mais aussi des contraintes de la compilation et de leurs choix. Les herbiers ne cherchent pas à inventorier toutes les espèces connues et ne se conforment pas à un modèle défini. Leur comparaison devrait aider à saisir la connaissance réelle qu’ont les auteurs des plantes qu’ils décrivent, ainsi que l’intérêt qu’ils y trouvent au vue des informations qu’ils sélectionnent. La façon de présenter les différentes données concernant une substance végétale doit également être prise en compte pour tenter d’y déceler d’éventuelles tentatives d’organisation. C’est en croisant les descriptions d’herbiers que peut être mesuré le degré d’appropriation des autorités compilées par les auteurs de la fin du Moyen Age, ainsi que l’enrichissement de cet héritage. Pour beaucoup d’entre eux, l’objectif est de savoir à quelle plante connue les sources font allusion. Or, les contraintes de l’identification devraient aboutir indirectement à une meilleure connaissance des différentes espèces végétales. D’autres types d’ouvrages, qu’ils soient rattachés à la médecine ou à l’agriculture, contribuent également à une approche plus individualisée de la
Description: