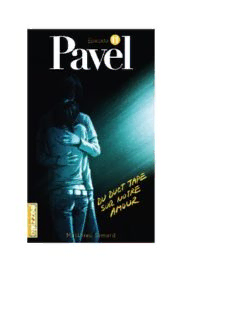
Du duct tape sur notre amour PDF
Preview Du duct tape sur notre amour
Les larmes des autres sentent bizarre. Une espèce d’odeur de vieillesse, comme l’air d’un grenier qu’on ne visite jamais. Elles sentent le renfermé, la peine qu’on a cachée, la porte qu’on ouvre après des années. Quand quelqu’un pleure dans mes bras, je suis dans un vieux grenier, et l’humidité se répand partout sur mes joues, dans mon cou, et c’est tiède. Tiède comme le malaise. Anouk m’étouffe avec ses bras, me déforme le visage avec ses lunettes, et pleure à en faire des flaques par terre. Je ne sais pas comment réagir. Ça me rend mal à l’aise, ce malheur, cette odeur de vieux coffre plein de secrets. Je ne pense pas être la meilleure personne sur qui déposer toutes ces larmes. Anouk a des fuites. Elle fond. Elle coule. Ça me prend un plombier. Une quincaillerie. Des outils. Du duct tape sur notre amour Mes larmes, à moi, ne sentent rien ; mais c’est parce que j’ai le nez bouché. Je me suis mis à pleurer par dépit, parce que je ne savais pas quoi faire d’autre. Je ne suis pas bon avec les gens. Anouk ne dit rien. Elle me serre dans ses bras, et ses yeux coulent dans mon cou. Il fait froid, il neige un peu, mais la porte attendra. Parce que la douleur, elle, n’attend pas. Et je ne comprends rien, ni ces sanglots, ni cette neige, ni sa peine, ni son tremblement. J’ai l’image d’une Anouk forte, tellement forte. Et si elle était fragile ? Elle est peut-être brisée. Il faut peut-être que je la répare. Ça me prend du duct tape. • • • Un dimanche soir d’automne enneigé. Anouk et moi nous tenons à mi-chemin entre l’intérieur et l’extérieur de ma maison. Il faudrait bien qu’on se décide à entrer pour de vrai, mais ce sera pour plus tard. Là, on est occupés. Si, un jour, vous décidez d’oublier une fille pour toujours, de la sortir de votre vie, de passer à autre chose, il serait préférable que la fille en question s’abstienne de sonner à votre porte au cours des heures qui suivent votre décision. Depuis cet après-midi, tout était pourtant clair dans ma tête : plus d’Anouk dans ma vie, plus de grand frère non plus, et certainement pas d’images de ces deux-là ensemble dans le fond de ma tête. Facile. C’était le plan parfait. Jusqu’à ce que ding-dong-j’ai-besoin-de-toi-Martin. Le plan ? Quel plan ? Dès cette seconde, j’oublie d’oublier Anouk. Je ne sais pas pourquoi elle a besoin de moi, sûrement pour la sauver de mon frère, mais ce n’est pas important. Je regarde les flocons tomber dans la rue, et je sais que je ne pourrais jamais la repousser. Je veux qu’elle reste dans mes bras pour toujours. — Je suis là, Anouk. Je l’aime. Toute la force du monde ne peut pas effacer ça. Je ne peux pas arrêter de l’aimer. Parce que je l’aime, justement. C’est tordu comme ça. Nous sommes dans l’entrée, bercés par le vent froid qui entre dans la maison vide, et j’attire tranquillement Anouk vers l’intérieur. Du pied je referme la porte, et c’est comme si, seuls ensemble dans la maison, on se retrouvait soudain seuls ensemble dans l’Univers. Je la serre encore plus fort contre moi. J’ai la bouche contre son oreille, je peux chuchoter plus doucement qu’un souffle. — Tout va bien aller... — Tu penses ? — Je te le promets. — Je sais pas... — Qu’est-ce qui se passe ? C’est mon frère ? — Non... Anouk me repousse doucement, comme si c’était à mes yeux qu’elle voulait parler. — Non, ç’a rien à voir avec ton frère. C’est fini avec lui. De toute façon, on peut même pas dire que ç’avait commencé. Elle a cessé de pleurer. Les traces de larmes sur ses joues la rendent encore plus belle. La tristesse lui va bien. Elle m’apparaît plus sensible, plus fragile, et moi je me sens d’autant plus fort, d’autant plus mâle. — Qu’est-ce qui se passe, alors ? — C’est à cause de mon père. • • • Retour en arrière, plus tôt dans la journée. Dans la Buick noire conduite par Frigo, l’inquiétude pèse des tonnes. On s’en retourne au labo. Il est 15 h 20. Le toit du collège ne semble pas avoir fait de bien à Pavel. Recroquevillé dans un coin de la banquette arrière de la voiture, il est toujours aussi vert, toujours aussi souffrant. Toujours aussi incapable de guérir. Je suis assis à ses côtés, et je n’ose pas parler. L’impression que même le souffle de mes paroles lui ferait mal. Au volant, Frigo est perdu dans ses pensées coupables. Pavel soupire. — Quand j’étais à Moscou... Pendant deux ans, on a fait des expériences sur moi. Il parle lentement, en appuyant chaque mot comme s’il voulait être certain de ne pas en oublier. Il grimace. — J’ai beaucoup souffert, là-bas. On m’avait enfermé dans une petite pièce sans fenêtre, avec une table en bois. Sur la table, il y avait un petit matelas sale. Moi, j’étais sur le matelas. C’était humide, je m’en souviens très bien. Je pensais que les murs allaient... comment on dit ? Rouiller. Oui. Je n’ose pas l’interrompre. Parler semble lui faire du bien. Au volant, Frigo a ralenti, comme pour s’assurer de ne pas arriver au labo avant que Pavel ait terminé son histoire. — Mais tu sais quoi, Martin ? Malgré la souffrance et l’humidité, je n’étais pas malheureux. Pavel prend une grande respiration. — Non, je n’étais pas malheureux. Parce que j’avais mon père. Trois heures par jour, il était avec moi. Parfois plus. Il me tenait la main. Nous n’avions pas besoin de nous parler. Nous étions effrayés, mais nous étions ensemble. Il tente un sourire, mais c’est une grimace qui apparaît. — J’aime mon père. • • • On est dans le sofa du salon, Anouk et moi. C’est dimanche soir. Anouk boit de l’eau. Moi, je mange ma lèvre inférieure. Anouk tremble. J’aurais envie d’en savoir plus sur elle et Stéphani, sur cette non-histoire qui m’a tant détruit. J’aimerais poser des milliards de questions là- dessus, mais ce n’est pas le temps. C’est le temps de l’écouter. Et c’est étourdissant. La fille de mes rêves, qui m’a obsédé jusqu’à ce qu’elle me détruise, qui m’a détruit jusqu’à ce que je l’oublie, que j’ai oubliée jusqu’à qu’elle réapparaisse, s’ouvre à moi comme si on avait passé notre vie ensemble. Et pendant ce temps-là, moi, je ne sais pas encore si j’ai le droit de l’aimer. — Je t’avais dit que j’habitais chez mon père. C’est pas vrai. J’habite chez les Saint-Onge, un couple de vieux qui connaissaient bien mes grands-parents. Ils sont vraiment fins avec moi, ils me traitent comme si j’étais leur petite-fille. — Fait que... Quand tu me parlais de tes parents... — Je parlais d’eux. — Quand on cherchait Pavel et que tu m’as dit que ton père t’avait suggéré d’aller voir la police ?... — C’était eux. — Je comprends pas. — Mon vrai père, il est resté dans mon village. J’essaie de lui parler le moins possible. Je suis venue à Montréal pour m’éloigner de lui. Au début, ça l’arrangeait, il disait que ça ferait du bien à tout le monde. Il a payé mes frais de scolarité, il m’envoie de l’argent chaque mois pour mes dépenses... Je pensais que... Mais là... Anouk prend quelques secondes pour respirer. — Mais là, il a décidé que c’était assez, qu’il ne voulait plus que je sois à Montréal. Il a appelé les Saint-Onge, il leur a dit qu’il ne m’enverrait plus d’argent. Et il les oblige à me retourner chez lui. Eux, ils m’aiment bien, mais qu’est-ce que tu veux qu’ils fassent ? — Toi, tu veux pas t’en retourner là-bas ? — Je peux pas. Je peux vraiment pas... • • • Dimanche après-midi. Frigo, Pavel et moi venons d’entrer dans le laboratoire. Il est 15 h 40. Les employés du labo ne fourmillent pas, aujourd’hui. Ils jasent, ils traînent. Ils sont une douzaine, en uniforme noir, au milieu du hall principal. Quand ils aperçoivent le visage vert de Pavel, ils ne réagissent même pas. On avance un peu vers eux. Toujours pas de réaction. Pas de volonté de prendre des notes, d’analyser, d’aider. À croire qu’ils font la grève. Pendant que Frigo aide Pavel à s’approcher de la fenêtre, pour qu’il bénéficie au moins d’un peu de lumière, je me dirige vers le bureau de Bourgeois.
