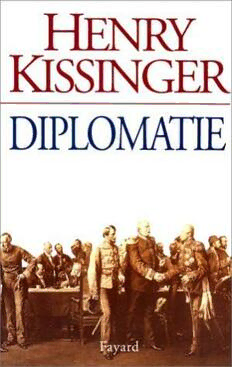
Diplomatie PDF
Preview Diplomatie
Henry Kissinger DIPLOMATIE traduit de l'anglais (ÉtatsUnis) par Marie-France de Paloméra Fayard Titre original: DIPLOMACY Éditeur original: Simon & Schuster, New York. Du même auteur : A World Restored: Castelreagh, Metternich and the Restoration of Peace 1812-1822, Houghton Mifflin, 1957. Paru en français sous le titre Le Chemin de la paix, Denoël, 1972. Nuclear Weapons and Foreign Policy, Harper and Row, 1957. The Necessity for Choice: Prospects of American Foreign Policy, Harper and Row, 1961. The Troubled Partnership : A Re-appraisal of the Atlantic Alliance, McGrawHill, 1965. Paru en français sous le titre Les Malentendus transatlantiques, Denoël, 1965. Problems of National Strategy : A Book of Readings, Henry A. Kissinger ed., Praeger, 1965. American Foreign Policy, Norton, 1969. Paru en français sous le titre Pour une nouvelle politique étrangère américaine, Fayard, 1970. White House Years, Little, Brown and Company, 1979. Paru en français sous le titre À la Maison-Blanche (2 vol.), Fayard, 1979. For the Record: Selected Statements 1977-1980, Little, Brown and Company, 1981. Years of Upheaval, Little, Brown and Company, 1982. Paru en français sous le titre Les Années orageuses (2 vol.), Fayard, 1982. © Henry A. Kissinger, 1994. Tous droits réservés. © Librairie Arthème Fayard, 1996, pour la traduction française. Table 1. Le nouvel ordre international 1 2. La charnière: Theodore Roosevelt ou Woodrow Wilson 21 3. De l'universalité à l'équilibre: Richelieu, Guillaume d'Orange et Pitt 47 4. Le Concert européen:la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie 67 5. Deux révolutionnaires: Napoléon III et Bismarck 91 6. La Realpolitik se retourne contre elle-même 123 7. Une machine de destruction politique: la diplomatie européenne avant la Première Guerre mondiale 151 8. Dans le tourbillon: la machine de destruction militaire 183 9. Le nouveau visage de la diplomatie:Wilson et le traité de Versailles 199 10. Le dilemme des vainqueurs 225 11. Stresemann et la réémergence des vaincus 243 12. La fin de l'illusion: Hitler et la destruction de Versailles 263 13. Staline pousse les enchères 291 14. Le pacte germano-soviétique 309 15. L'Amérique à nouveau dans l'arène: Franklin Delano Roosevelt 327 16. Trois approches de la paix: Roosevelt,Staline et Churchill dans la Seconde Guerre mondiale 351 17. Le début de la guerre froide 379 18. Les succès et les revers de l'endiguement 401 19. Le dilemme de l'endiguement: la guerre de Corée 425 20. Négocier avec les communistes:Adenauer, Churchill et Eisenhower 443 21. L'endiguement contourné: la crise de Suez 469 22. La Hongrie: un soulèvement dans l'empire 495 23. L'ultimatum de Khrouchtchev: la crise de Berlin, 1958-1963 511 24. L'unité occidentale: Macmillan, de Gaulle,Eisenhower et Kennedy 535 25. Le Viêt-nam: l'entrée dans le bourbier. Truman et Eisenhower 559 26. Le Viêt-nam: en désespoir de cause. Kennedy et Johnson 581 27. Le Viêt-nam: le désengagement. Nixon 611 28. La politique étrangère comme géopolitique:la diplomatie triangulaire de Nixon 637 29. La détente et ses déconvenues 665 30. La fin de la guerre froide: Reagan et Gorbatchev 693 31. Le nouvel ordre mondial reconsidéré 733 Notes 765 Remerciements 801 Index 821 Ce livre d'une exceptionnelle puissance raconte l'histoire mondiale de la diplomatie, du XVIIe siècle à nos jours. Pourquoi le XVIIe siècle ? Parce que c'est à cette époque que Richelieu invente la diplomatie européenne, désormais fondée sur la raison d'État, la défense de l'intérêt national, la recherche de l'équilibre entre les puissances. A cette tradition, les États-Unis, dès leur constitution, opposeront une autre façon de conduire les affaires étrangères, en affirmant la primauté des principes sur l'intérêt, de la coopération sur la compétition, de la sécurité collective sur l'équilibre des forces. Qui eut raison, qui eut tort? Qui est dans le vrai aujourd'hui ? C'est le plus souvent à travers de brillants portraits (ceux de Napoléon III, de Bismarck, de De Gaulle, de Truman, de Reagan sont inoubliables) que se dit le sentiment profond du spécialiste. Et l'on se régalera de l'humour et de la vigueur qui donnent leurs couleurs à cette fresque aux tons vifs et contrastés. Ancien professeur à Harvard, l'un des meilleurs analystes au monde des relations internationales, Henry Kissinger fut aussi un grand diplomate. Conseiller du président des États-Unis pour la sécurité nationale de 1969 à 1975, secrétaire d'État de 1973 à 1977, prix Nobel de la paix, il a publié notamment quatre volumes de mémoires: A la Maison-Blanche (1968-1973), 2 vol. (Fayard, 1979) et Les Années orageuses (1973-1974), 2 vol (Fayard, 1982). Traduit de l'anglais (États-Unis) par Marie-France de Paloméra. 1ère de couverture : photo © Culver Pictures 4' de couverture : photo © Chinese Press 35-9720-0 198,00 FF TTC Aux hommes et aux femmes du Foreign Service des ÉtatsUnis d'Amérique, dont le professionnalisme et le dévouement nourrissent la diplomatie américaine 1 Le nouvel ordre mondial Il semblerait qu'à chaque siècle surgisse, avec une régularité qui ferait croire à une loi de la nature, un pays ayant la puissance, la volonté et l'élan intellectuel et moral nécessaires pour modeler le système international conformément à ses valeurs propres. Au XVIIe siècle, la France de Richelieu introduisit la conception moderne des relations internationales, fondée sur l'Étatnation et déterminée par la recherche de l'intérêt national comme but ultime. Au XVIIIe siècle, la GrandeBretagne définit la notion d'équilibre des forces qui domina la diplomatie européenne pendant les deux siècles suivants. Au XIXe siècle, l'Autriche de Metternich reconstruisit le Concert européen et l'Allemagne de Bismarck le démantela, transformant la diplomatie européenne en un jeu impitoyable de politique de puissance. Au XXe siècle, aucun pays n'a exercé d'influence aussi décisive et, en même temps, aussi ambivalente que les ÉtatsUnis. Aucune société n'a dénoncé avec plus de vigueur le caractère inadmissible de l'ingérence dans les affaires intérieures des États, ni affirmé avec plus de passion la nature universelle de ses valeurs. Aucune nation n'a montré plus de pragmatisme dans la conduite ordinaire de sa diplomatie ni plus d'idéologie dans la poursuite de ses convictions morales historiques. Aucun pays n'a jamais autant hésité à se lancer dans des entreprises lointaines, alors même qu'il nouait des alliances et prenait des engagements d'une portée et d'une ampleur sans précédent. Les particularismes que l'Amérique s'est assignés tout au long de son histoire ont déterminé chez elle deux attitudes contradictoires en matière de politique étrangère. Elle sert au mieux ses valeurs en perfectionnant la démocratie sur son territoire, se posant ainsi en phare pour le reste de l'humanité; mais ses valeurs lui imposent l'obligation de mener des croisades dans le monde entier. Prise entre la nostalgie d'un passé marqué par l'innocence et le désir d'un futur parfait, la pensée américaine a oscillé entre l'isolationnisme et l'engagement, encore que les réalités de l'interdépendance aient joué un rôle prédominant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les deux écoles de pensée - l'Amérique phare du monde et l'Amérique menant croisade - aspirent à un ordre international fondé sur la démocratie, la liberté du commerce et le droit international. Comme aucun système de cette nature n'a encore existé, les autres sociétés voient dans cette aspiration sinon de la naïveté, du moins une utopie. Pourtant, le scepticisme de l'étranger n'a jamais terni l'idéalisme de Woodrow Wilson, de Franklin Roosevelt ou de Ronald Reagan, ni à vrai dire d'aucun président américain du xxe siècle. Il aura tout au plus renforcé le credo américain: on peut triompher de l'histoire, et le monde, s'il veut vraiment la paix, doit appliquer les prescriptions morales de l'Amérique. Les deux écoles de pensée résultent de l'expérience américaine. Bien d'autres républiques ont existé, mais aucune n'a été instituée en vue de réaliser l'idée de liberté. La population d'aucun autre pays n'a décidé de partir à la conquête d'un nouveau continent et d'en dompter les espaces inexplorés au nom de la liberté et de la prospérité pour tous. C'est ainsi que les deux approches, isolationniste et missionnaire, si contradictoires en surface, reposent sur une même conviction: les ÉtatsUnis possèdent le meilleur système de gouvernement au monde, et le reste de l'humanité peut parvenir à la paix et à la prospérité en renonçant à la diplomatie traditionnelle et en vénérant, comme l'Amérique, le droit international et la démocratie. L'odyssée américaine dans les eaux de la politique internationale aura marqué le triomphe de la foi sur les réalités de l'expérience. Depuis le jour où elle est entrée dans l'arène de la politique mondiale en 1917, l'Amérique a exercé une influence si prépondérante et a été si convaincue du bienfondé de ses idéaux que les grands accords internationaux du siècle ont incarné ses valeursde la Société des Nations et du pacte Briand-Kellogg à la charte des Nations unies et à l'acte final d'Helsinki. L'effondrement du communisme soviétique a ensuite pleinement justifié la pertinence des idéaux américains sur le plan intellectuel et contraint paradoxalement l'Amérique à se confronter à un monde qu'elle avait tenté de fuir tout au long de son histoire. Dans l'ordre international qui se met en place, le nationalisme a pleinement droit de cité. Dans l'histoire, les nations ont recherché la satisfaction de leur intérêt égoïste plus souvent que l'application de leurs nobles principes, et se sont posées en rivales plus souvent qu'elles n'ont coopéré. Rien n'indique que ce comportement séculaire ait changé, aucun indice n'annonce sur ce point de transformation notable dans les prochaines décennies. Ce qui est nouveau, en revanche, dans ce nouvel ordre planétaire, c'est que, pour la première fois, les ÉtatsUnis ne peuvent ni prendre leurs distances avec le monde ni le dominer. L'Amérique ne peut modifier l'idée qu'elle s'est forgée de son rôle au cours de son histoire, et ne doit pas davantage le souhaiter. Lorsqu'elle est entrée dans l'arène internationale, elle était jeune et robuste, elle avait le pouvoir de conformer l'univers à sa vision des relations internationales. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, les ÉtatsUnis étaient si puissants (il y eut une période où près de 35 % de la production économique mondiale était américaine) qu'ils semblaient appelés à modeler le monde selon leur goût. John F. Kennedy affirmait avec confiance en 1961 que l'Amérique était assez forte pour «payer n'importe quel prix, assumer n'importe quel fardeau» afin d'assurer le triomphe de la liberté. Trente ans plus tard, les ÉtatsUnis ne se trouvent guère en position d'exiger la réalisation immédiate de tous leurs désirs. D'autres pays ont acquis le statut de «grande puissance ». Les ÉtatsUnis doivent tenter aujourd'hui d'atteindre leurs buts par paliers successifs, chacun d'entre eux constituant une sorte d'amalgame des valeurs américaines et des nécessités géopolitiques. Une de ces nécessités nouvelles est qu'un monde comprenant plusieurs États de force comparable doit fonder son ordre sur une notion quelconque d'équilibre - une idée avec laquelle les ÉtatsUnis ont toujours été en délicatesse. Lorsque la réflexion américaine sur la politique étrangère et les traditions de la diplomatie européenne se sont retrouvées face à face à la conférence de la paix de Paris en 1919, la différence de leurs histoires est apparue en pleine lumière. Les dirigeants européens voulaient conforter le système existant en recourant aux méthodes habituelles; les conciliateurs américains estimaient que la Grande Guerre était le résultat non pas de conflits géopolitiques insolubles, mais de pratiques européennes imparfaites. Dans ses célèbres «quatorze points», Woodrow Wilson déclara aux Européens que l'ordre international devait se fonder désormais non plus sur l'équilibre des forces, mais sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que leur sécurité devait dépendre non plus d'alliances militaires, mais de la sécurité collective, et que leur diplomatie ne devait plus être conduite en secret par des spécialistes, mais sur la base d'« accords ouverts, conclus ouvertement ». De toute évidence, Wilson venait moins débattre de la fin de la guerre ou restaurer l'ancien ordre international que refondre la diplomatie qui se pratiquait depuis près de trois siècles.
